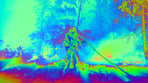Est-on un pays de Gaulois réfractaires ?
Les Français : jamais contents ?


La réponse est oui les amigos.
Voilà.
Bon ben c’est plié, à la prochaine.
AU FAIT - Interruption des programmes
CDLT fait une petite pause après cette édition pour cause de je fais une petite pause (communément appelée “des vacances”). T’façon vous avez plein de ponts vous verrez même pas le temps passer. On se retrouve dans 3 semaines si j’ai la foi, dans un mois si on est réaliste.
J’avoue, j’ai tenté un faux suspense pour vous faire cliquer : savoir si on est une belle bande de râleurs n’est pas du tout le sujet de l’article. Parce que, merci du scoop. D’après l’étude Fractures françaises de 2023 (Ipsos x Le Monde, La Fondation Jean Jaurès, le Cevipof, l’Institut Montaigne, l’Empereur, sa femme et le Petit Prince) : 96% des Français·es sont mécontent·es en 2023. Je suis pas statisticienne mais je dirais que ça fait beaucoup.
Mais en fait, le sujet de l’article c’est : pourquoi notre capacité à nous plaindre beaucoup est en fait plutôt une bonne chose.
Je suis récemment rentrée en France après 6 ans d’expatriation dans deux pays. Et maintenant que j’ai benchmarké, je peux réduire à trois items la liste des trucs d’ici qui m’ont profondément, intimement manqué :
1/ Le St Morêt ce don des dieux. Si vous vivez dans un endroit avec un accès libre à cette merveille, je vous le dis tout de suite : vous vous rendez pas compte de votre chance. Après 6 ans à me taper des ersatz américains tout aussi chers mais tellement crémeux leur race on dirait de la Vaseline, retrouver son petit goût primeur est une source de joie quotidienne. Est-ce qu’il y a un plus grand prodige agroalimentaire, je vous le demande ? Sa petite robe nacrée là, sa texture juste ce qu’il faut de tartinable tout en résistant un poil sous le couteau, sa douceur onctueuse qui masque à peine sa subtile acidité, sa pointe de sel qui lui donne du caractère sans donner soif, le fait qu’il rend TOUTES LES RECETTES meilleures (j’ai essayé) : pardon hein, PARDON, mais qu’est-ce qui nous faut de plus dans la vie je vous le demande ? Je veux dire, à part un toit et de l’amour ? J’accepte le fouetté de Madame Loïk en contender, mais venez pas me parler d’autre chose.
2/ La Sécu pour peu ou prou les mêmes raisons.
3/ Notre fabuleuse capacité à nous plaindre d’absolument tout. Je déconne pas. Ça m’a manqué instantanément, dès plus ou moins ma première interaction sur un autre sol. Naïve, je SAVAIS que râler était notre sport national, mais je pensais qu’on avait réussi à l’exporter, comme le vin et les Rafale. Alors que non.
Je pense que notre capacité à nous plaindre est un fucking trésor national - bien plus que Johnny, qui a plutôt niqué le Trésor et qui n’est pas un national - et qu’il faut qu’on la protège et la chérisse comme si notre vie en dépendait (car c’est le cas). Je l’aime du plus profond de mon coeur. J’ai absolument aucun souci avec le fait qu’on soit un pays jamais content alors que nous avons 1/ le St Morêt et 2/ la Sécu, au contraire, je pense profondément que nous avons le 1/ St Morêt et 2/ la Sécu PARCE QUE nous ne sommes jamais contents.
J’ai déjà traité de questions annexes, comme de savoir si les Français détestent le travail, ou la question de savoir si une relation win-win y était possible, alors qu’on a hérité d’une culture d’opposition patronnat-salariat. Et derrière ces questions-là, il y a toujours la même petite musique : t’façon les Français sont jamais content·es. Sont pas content·es de ce qu’iels ont, sont pas content·es de ce qu’on leur propose. Insatisfaits ET réfractaires au changement. Ingérables, impossibles à manager, impossibles à diriger, mais surtout inaptes à évoluer. En bref, se plaindre = immobilisme.
J’suis pas super d’accord.
Mais avant d’expliquer exactement pourquoi, passons par l’habituel détour définitionnel.
Chiant lexical
Car bien évidemment, comme les Inuits auraient soi-disant 50 mots pour dire la neige (y’a une page Wikipédia entière sur ce qui va pas dans cette idée reçue), on a plein de mots pour désigner l’expression du mécontentement.
Si on faisait un mapping, ce qu’on ne fera pas car la vie est courte (enfin la mienne, car je suis fumeuse) on les classerait selon un axe pas sérieux —> sérieux, et un axe passif —> actif. Parce qu’évidemment, tous les râlages ne se valent pas.
Cinquante nuances de griefs
Ça commence par “se plaindre”, qui peut être sérieux ou pas, actif ou pas, et qui est un peu le terme générique, la toile blanche de la doléance.
Ça continue avec “râler” (Berry), qui a plus de panache. Sur le papier, “râler” c’est pas sérieux, ça n’a pas vocation à changer le monde, et pourtant, ça a été étudié : ça permet de laisser sortir ses émotions plutôt que de les laisser s’accumuler comme un Coca trop secoué dont les parois rigides indiquent qu’on ne va pas passer un bon moment.
Ça enchaîne sur “rouspéter” qui est la variante du râlage pour les hommes d’un certain âge qui ont accumulé une vie entière d’émotions refoulées et qui les libèrent de façon indiscriminée sur absolument tout, des horaires d’ouverture de BricoDépôt au fait que vous mettiez toujours les pieds sur le canap.
Ça fait un détour par la “grogne”, qui généralement désigne un sérieux appel au changement, MAIS qui est utilisée par les médias pour donner l’impression que c’est l’inverse. Appliquée généralement aux profs, personnel médical, agriculteurs qui se battent plus où moins pour leur survie et notre avenir mais qu’on fait passer pour des relous. Quand ça s’organise un peu, ça devient une “fronde” mais c’est le même bail, ça te dit gens qui courent dans les champs avec un lance-pierre, c’est pas du tout glorieux.
Ensuite il y a (Bernard) “ruminer”, qui revient à se plaindre, mais à soi-même. C’est le terreau dont on fait les ulcères.
On monte d’un cran avec le “cynisme” (de Panama), qui est éminemment passif, et souvent un moyen de sauver la face quand on a peur ou qu’on n’ose rien faire. Ça sert à que dalle, ça donne l’air cool et distant cinq minutes mais au fond, c’est relou.
Ça termine avec la griotte sur le gâteau du grief : l’aigreur, qui n’est plus une action, mais un état. Être aigri·e ça veut dire qu’on est passé de l’autre côté, et qu’on n’a plus aucun recul. C’est globalement pas ouf, mais dans les cornichons c’est super.
En bref
Dans ce super article du NYT, la journaliste résume les études sur le sujet en disant qu’il y a environ 3 niveaux de plainte :
le “venting” : qui correspond à peu près à râler. On l’a établi, ça peut être utile pour lâcher un peu de pression, tant que ça devient pas une personnalité.
le “problem-solving” : c’est se plaindre d’un truc pour mieux le régler. C’est digne, c’est classe. La Rolls-Royce du seum.
le “ruminating” : ça, ça sert à rien d’autre que se faire du mal.
Vous l’aurez compris : quand je dis que j’ai une passion pour notre capacité à nous plaindre, je parle de celle qui sert à quelque chose (les deux premières quoi) pas celle qui fout une sale ambiance.
Maintenant je vais enfin expliquer enfin les vertus que j’y trouve.
Se plaindre, ça crée du lien
Comme toujours, la grandeur de notre culture c’est les autres qu’en parlent le mieux. Même si les étrangers sont persuadés qu’on sait élever nos enfants, qu’on bosse vraiment 35h et qu’on mange du calendos au petit-dej en fumant des Gauloises, y’a de lumineuses perles de sagesse à aller glaner dans les articles à moitié ethno qu’on écrit pour tenter de comprendre notre peuplade.
Dans celui-ci sur le site de la BBC, on apprend, et je trouve ça d’une justesse rafraîchissante, que râler est une “façon d’inviter les opinions des autres”. Que la conversation en France est un peu un duel d’intellects, et que se plaindre est à la fois une façon de montrer sa propre absence de naïveté, et d’appeler à la confrontation des idées. D’ailleurs, y’a des gens qu’ont étudié le bail et affirment que ouais, en fait, c’est pas un mauvais outil pour créer du lien même dans le travail.
L’autrice, qui s’appelle Emily, est Américaine et vit à Paris (et qui a donc dû douiller un peu y’a quelques années) compare tout ça avec la culture anglo-saxonne, où l’on évite de se plaindre pour éviter de passer pour un·e “loser”. Et c’est super intéressant : elle cite Anna Polonyi, une auteure Franco-Hongro-Américaine, qui explique qu’il n’y a pas vraiment de mot pour dire “loser” en France (venez pas chipoter, y’a que Bernard Tapie pour dire “perdant”). Car pour qu’on vous traite de “loser”, “il faut que tout le monde autour de vous pense en termes de gagnant/perdant”, or c’est pas vraiment comme ça que les Français voient les interactions sociales.
Je trouve ça assez beau, perso. L’idée qu’on se permet de se plaindre parce que, d’une certaine façon, on a confiance dans le fait que l’autre ne viendra pas nous étiqueter instantanément. Qu’on est finalement en train d’essayer de trouver un terrain d’entente sur quelque chose sans y jouer notre identité, personnelle ou professionnelle. Au fond, parfois on se plaint pour se plaindre, dans cet espèce de terra nullius sécurisée qu’on appelle le second degré (et qu’on est plus ou moins les seul·es à avoir, n’essayez pas ça ailleurs, j’ai testé pour vous).
D’ailleurs, quand on lit les témoignages des salarié·es qui ont pris cher dans des boîtes toxiques (sur Balance ton agency, ta startup ou les autres), y’a souvent un truc qui ressort : le management était terrible, mais la cohésion de l’équipe était incroyable et salvatrice. Au fond, bien que ça soit pas souhaitable (me faites pas dire ce que je dis pas), être caustiques ensemble, ça soude.
Se plaindre, ça défoule
J’ai cité plus haut les études en faveur de ce point. En gros, elles disent que globalement, accepter et exprimer ses émotions négatives c’est mieux que de les accumuler, et MÊME, que ça rend plus résilient·e à long-terme.
Mais voilà, je trouve qu’on manque grave d’avocats du diable dans la vie (non, vraiment pas hein) (si vous avez cette tendance, merci de cesser) donc je vais faire le mien et me pencher sur les avis en défaveur.
Et évidemment, les avis en défaveur citent des fat études bien chiantes à lire, comme celle-ci, que j’ai donc lue car j’adore me pourrir la vie (comme ça ensuite je peux me plaindre). En bref, les chercheurs·es ont fait écrire à plein de salarié·es des petits journaux sur comment ça va - bien ou bien - selon ce qui se passe dans leur vie au bureau, et utilisent ensuite beaucoup de mots pour dire plusieurs choses simples :
quand il se passe des trucs pas oufs dans le taf, ça nous affecte (je vous promets qu’il leur faut plusieurs paragraphes pour exposer ce concept révolutionnaire). On se parle de trucs relous mais pas trop graves, genre un ordi qui plante, un planning pas clair, une erreur, une prise de tête avec quelqu’un.
mais il semblerait que ça nous affecte moins, et moins longtemps, quand on prend les choses bien et qu’on évite de se plaindre. Et qu’en plus ça soit positif à long-terme parce que les autres (notamment les boss) nous perçoivent mieux.
la raison évoquée est globalement qu’en se plaignant, on revit l’événement, on le rend plus saillant dans notre mémoire et on exagère sa portée.
Voilou.
SAUF QUE BIEN SÛR j’ai des trucs à redire :
le premier c’est qu’il y a absolument ZÉRO prise en compte du contexte dans leur analyse. Peut-être que, chsépa hein, les gens qui prennent pas trop mal les trucs relous étaient DÉJÀ plus heureux, déjà dans des boîtes où iels se sentaient bien, et que oui globalement quand ça va bien, c’est plus facile de pas en faire des caisses quand une merde nous arrive.
le second, à leur décharge ils l’exposent eux mêmes : c’est que ça remet toute la responsabilité sur les salarié·es, mais surtout que des études montrent qu’à long-terme, se plaindre et mal réagir à de l’injustice et de la maltraitance, c’est globalement ça qui peut faire bouger les choses. Donc oui, on pourrait tenter l’hypothèse que c’est de ne rien dire qui favorise l’immobilisme. Mais on y vient.
Se plaindre, ça fait avancer le schmilblick
Si.
Déjà, si on se plaignait jamais, on aurait encore un roi.
Et puis probablement que les enfants travailleraient toujours dans les usines.
Mais si on part du principe que tout n’est pas rose dans la vie et qu’il y a toujours des choses à améliorer, y’a globalement trois options : prendre sur soi et se dire que c’est pire ailleurs (j’appelle ça du nivellement par le bas), faire l’autruche (et ça finira par péter) ou… se plaindre et essayer de changer les choses.
À une époque où l’on est assailli d’injonctions à la positivité (j’en parle ici), on oublie que c’est souvent d’émotions négatives que provient la volonté de changement. Et au fond, se plaindre veut dire deux choses : d’une part, qu’on a des standards élevés, et d’autre part, qu’on croit qu’il est possible d’aller vers le mieux (ça veut possiblement dire une troisième chose, c’est que l’injonction à la positivité est FAITE pour maintenir le status quo, mais ça serait conspi, hein).
Tout ça pour dire que je trouve toute cette négativité éminemment positive.
Il y a un symptôme que je trouve super intéressant, dans le cadre de l’entreprise : le turnover (le taux de rotation du personnel, bref les gens qui partent vs les gens qui arrivent). Un turnover élevé, c’est quand des gens préfèrent partir que d’attendre que les choses s’améliorent. Le turnover, c’est extrêmement coûteux pour une boîte (le Retention Report aux US l’estime à 15K$ par employé·e). Eh bien d’après une étude en 2020, 78% des raisons pour lesquelles les employé·es quittent leur job auraient pu être évitées par l’employeur. Trois options alors : soit les employeurs s’en foutent (et les employeurs ne se foutent JAMAIS de trucs qui leur coûtent de la thune), soit iels ne peuvent pas changer les choses, soit iels n’ont pas les infos qui permettraient d’éviter que les gens partent. Ce dernier point ouvre la question hautement complexe mais essentielle de trouver les moyens d’inviter les retours, même négatifs, venant d’en bas. Car si c’est jamais fun ça peut être sacrément utile.
Et on peut me rétorquer (car en plus de faire l’avocat du diable, je fais ma propre contradiction) que oui, mais on abuse un peu nous. Qu’on a quand même de super conditions de vie. Je répondrai d’une part qu’on a peut-être de super conditions de vie parce qu’on a derrière nous des palanquées de gens qui se sont plaints. Et qu’ensuite, peut-être qu’il y a quand même des choses à redire, ce qui m’amène naturellement à mon dernier point.
Se plaindre, c’est une preuve de lucidité
Evidemment qu’en France on est farci·es de paradoxes comme une dinde de marrons.
Dans ce très bel article (de la catégorie “ethno de ce peuple étrange et attachant”), la professeure britannique Ilona Boniwell parle du “French Unhappiness Paradox”.
En bref, vu de l’extérieur, on a tout pour être heureux·se (St Morêt, sécu, démocratie, Etat-providence bonne bouffe, paysages incroyables, St Morêt), et pourtant, on l’est pas (selon le Gallup World Poll, à peine plus que la moyenne). On peut évidemment se dire que c’est parce qu’on est des relou·es.
Mais si on prend un poil plus de temps (et vu que vous lisez cet article depuis déjà 3 heures et 14 minutes, on n’est plus à ça près) et qu’on se penche par exemple sur le “European Social Survey”, seul·es 9% des Français·es se considèrent prospères (vs. 33% des Danois). Selon L’Eurobaromètre et le “World Values Survey”, on n’est pas très loin de l’Europe de l’Est en termes de standards de vie. Ajoutons, j’en ai déjà parlé, qu’on va pas ouf, avec l’une des plus hautes consommations d’antidépresseurs en Europe. L’autrice fait aussi tout un point sur l’école, ses promesses non-tenues de méritocratie et sa capacité à foutre une pression dingue sur les gamins.
Aux datas de la dame, j’ajouterais les miennes (enfin, celles de la Fondation Jean Jaurès) : 82% des Français·es pensent que la France est en déclin (dont 34% que c’est irréversible), 46% sont inquiet·ètes pour leur pouvoir d’achat, 30% pour l’environnement et 24% pour l’avenir du système social. Et puis je vous épargne un petit point sur l’actu du moment, hein, je pense que vous voyez.
Moi, dans tout ça, je vous deux lignes directrices :
1/ la prise en compte du contexte : si tant de Français·es sont mécontent·es et pessimistes, surtout par rapport aux cultures anglo-saxonnes, c’est parce qu’on a une conception fondamentalement différente de ce qu’il faut pour réussir/que ça aille mieux. On a suffisamment regardé autour de nous pour ne pas croire qu’il suffit de vouloir pour y arriver (contrairement à la culture du self-made toussa). On sait que ça dépend de tout un paquet de facteurs externes, et qu’ils sont pas forcément réunis.
2/ l’idée du déclin : moi là-dedans, je ne vois pas seulement le fait qu’on a été feue une grande puissance blabla (même si). Je vois un truc tout con : le modèle français (de sécurité, Etat-providence, protection sociale, protection des travailleurs) rame à contre-courant par rapport au mouvement dominant de libéralisation (appelez ça le sens de l’histoire si vous voulez). En d’autres termes, à moins de faire un pataquès à CHAQUE réforme, chaque évolution, ça ne peut QUE se déliter. Bref, si l’on considère que ce qu’on a en France est bien, oui les choses vont vers le pire.
Moi je trouve tout ça très lucide.
En bref
Quand je fais des interviews (ouais maintenant je peux dire des phrases comme ça) (et croyez bien que je vais pas m’en priver), il y a toujours un moment où je dois expliquer pourquoi le sous-titre de cette newsletter c’est “hater-generated content”, et que ce n’est pas parce que c’est négatif que ce n’est pas constructif.
Je trouve marrant comment notre tendance, que je pense culturelle, à la négativité se heurte à l’époque. D’un côté, on a quand même pas mal de raisons d’avoir le seum, d’un autre il y aura toujours quelqu’un pour dire qu’on exagère, qu’il y a plus mal loti, des problèmes plus graves, et tutti quanti.
Ça n’a pas grand-chose à voir (enfin si, vous allez voir) mais je suis en train d’écouter Shame on you, un podcast assez incroyable de Marine Pradel et Anne-Cécile Genre, deux journalistes qui avaient couvert l’affaire DSK en 2011 et replongent aujourd’hui dans leurs archives de l’époque. Le portrait qu’elles brossent de cette période fout une énorme claque : outre les réactions insoutenables des soutiens de DSK, elles traitent de leur propre approche du sujet, et de celles des journalistes en France à ce moment-là. On y voit tous les biais qui nous semblent intolérables aujourd’hui dans une ère post-#metoo. Ce même #metoo qui avait bien sûr été critiqué pour toutes les raisons citées au paragraphe précédent. Et au fond, on voit à quel point la parole était déjà là, mais encore moins entendue, et entendable qu’aujourd’hui. Et même si on est loin d’être sorties de l’auberge, ça montre de façon éclatante le pouvoir d’ouvrir sa gueule fort et à plusieurs.
CDLT,
Sev