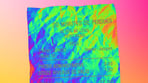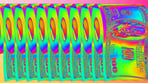"Dis-nous ce qu'on peut faire pour t'aider"
Burn-out : je vous demande de vous arrêter


❤️ POINT LOVE : j’écris ce petit bloc sur fond orange le lendemain de la soirée de lancement de Ciao les nazes au Comptoir des Mots, et que vous dire à part QUE JE MESURE MA CHANCE D’AVOIR UN LECTORAT AUSSI INCROYABLE ? C’EST FOU. C’EST FORMIDABLE. JE SUIS CHOQUÉE MAIS PAS DÉÇUE. Merci d’être venu·es, merci de m’avoir parlé de vous, vous êtes formidables, j’espère que j’ai pas été encore plus cheloue que vous imaginiez, MERCI.
🎙️ POINT PODCAST : cet article est dispo en version audio de 36 minutes, oui 36 minutes, sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer enfin quand Apple Podcasts et Deezer voudront bien actualiser.
Ça ne m’arrive pas souvent d’avoir une idée d’article à l’avance pour CDLT. Mais là, ça fait un bon gros mois et demi que je sais que je vais m’attaquer à ce big sujet bien baveux.
On va parler burn-out.
Et comme j’ai eu le temps de réfléchir à cet article, j’ai eu l’opportunité d’en parler autour de moi pendant le process. J’ai appris plusieurs trucs dans ce petit sondage Ipsauce x Séverine Bavon, et l’un de ces trucs est : la phrase “Dis-nous ce qu’on peut faire pour t’aider” prononcée face à une personne au bout du roul est LE trigger corporate universel.
Il n’y a pas une personne à qui je l’ai dite qui ne l’a pas comprise instantanément et n’a pas été traversée immédiatement de la tête aux pieds par un frisson glacé, suivi d’un petit pic de rage se traduisant, au choix, par des insultes que la décence me proscrit de partager ici, par un cri du cœur que les limites de l’écrit m’empêchent de retranscrire ou par un mouvement involontaire d’un membre, parfois d’un doigt, parfois le doigt du milieu.
Parce que la phrase “Dis-nous ce qu’on peut faire pour t’aider”, c’est tous les problèmes liés à l’épuisement professionnel compressés-de-César en quelques mots. C’est à la fois :
Une réponse profondément insatisfaisante faite à une personne qui, bien qu’elle soit au bout du scotch depuis un bail et qu’elle ait déjà évidemment tenté tout ce qui était en son pouvoir pour se sortir de la mierda, en arrive, malgré la peur que ça soit retenu contre elle comme une preuve de faiblesse, à lancer un SOS et à qui, plutôt que de la décharger, on ajoute une charge supplémentaire.
Un retour à l’envoyeur, une brique de plus dans le petit puits de responsabilité individuelle qu’on construit autour des gens, et qui consiste à faire comprendre aux individus que si ça ne va pas, c’est de leur faute, et donc que c’est à eux d’identifier les moyens de s’en sortir et de proposer des solutions, même si leur stock d’énergie vitale est complètement à sec.
Un symptôme de l’individualisation du travail, parce que quand on répond ça à quelqu’un, c’est très souvent parce qu’on ne sait pas comment l’aider. Parce que cette personne épuisée, eh bien elle est la seule à faire ou à savoir faire son taf, et qu’en réalité il est complètement impossible de l’en décharger ou de lui apporter une vraie aide, sinon on l’aurait déjà fait.
Une illustration de l’impuissance managériale, car la personne en position de management qui se retrouve à prononcer cette phrase est généralement bien consciente que la réponse est ailleurs. Face à une personne à bout de forces, a priori, la solution, c’est de lui retirer du taf, voire de la retirer momentanément du taf, puis d’essayer de comprendre comment on en est arrivé là et de faire des changements de fond dans l’organisation pour que ça n’arrive plus. Mais évidemment, si le/la manager (n’est pas une personne toxique qui crée volontairement les conditions pour pousser les autres à bout et) en avait les moyens et le pouvoir, iel l’aurait déjà fait. Donc on jette cette bouée de sauvetage en plastique fondu en sachant très bien que même si l’autre savait ce qu’on peut faire pour l’aider, ça ne serait qu’un Hansaplast sur une plaie nécrotique.
Si vous l’avez déjà entendue, cette phrase, je compatis. Si vous l’avez déjà prononcée, je compatis aussi, car à part quelques tordus, personne n’est indifférent et ne vit bien son impuissance face à la détresse d’une personne qui appelle à l’aide.
Et pourtant, cette détresse, cette phrase, et le burn-out persistent à se répandre. On a beau en entendre beaucoup, BEAUCOUP parler, du burn-out, ça ne semble pas suffire à l’endiguer. Au contraire.
Allez petite séquence chiffrée, ça sera fait. En 2025, 53 % des Français indiquaient avoir connu un épisode de souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. En 2023, les maladies psychiques reconnues d’origine professionnelle ont augmenté de 25 %, et 12 000 accidents du travail étaient liés à des risques psychosociaux (RPS). Selon Malakoff Humanis, la deuxième cause d’arrêts de travail étaient les troubles psychologiques ou l’épuisement professionnel, à 16 %, devant les troubles musculo-squelettiques (14 %). Un quart des arrêts longs sont liés à des troubles psy, part qui a doublé en 3 ans et touche ¾ des entreprises. Pour ce qui est de la prévalence des soucis psy dans la population en emploi, c’est plus compliqué : d’un côté, on a le baromètre Empreinte Humaine 2025 qui annonce que 47% des salariés sont en situation de détresse psychologique, ce qui clashe avec les dernières vraies données publiques qui datent de 2019 et disaient que la souffrance psychique en lien avec le travail touchait 5,9% des femmes et 2,7% des hommes. C’est chelou hein ? On y reviendra.
On en est à un point très bizarre, où le burn-out est globalement considéré comme une réalité… mais une réalité à la fois très nette et très floue. Très nette, parce qu’on y est absolument tous·tes confronté·es, chez nous, dans notre entourage ou parmi nos collègues. Très floue parce que… ben c’est à la fois un peu considéré comme un fait de la vie — un truc grave mais qu’on accepte comme une fatalité — et puis un truc qu’on peine vraiment à définir et à comprendre.
Et c’est un peu ça, qui m’a bloquée ces dernières années, à chaque fois que je me disais qu’il allait quand même falloir faire un article sur le burn-out dans CDLT. À chaque fois, je me disais que j’étais ni médecin ni psy ni avocate, et que j’étais donc particulièrement mal placée pour apporter quoi que ce soit à la réflexion.
Jusqu’à ce que je réalise… qu’a priori, je peux pas trop faire pire. Je veux dire, si on est dans le jus malgré le fait que plein de gens super intelligents se penchent sur la question… qu’est-ce qu’on a à perdre à ce que moi, je donne mon avis sur la question, même si c’est vraiment pas intelligent ?
Parce que j’ai un avis. Et il a beau être absolument pas expert, et potentiellement turbo-débile, il est très tranché. Mon avis, c’est qu’on comprend le burn-out complètement de travers. J’ai une définition extrêmement personnelle du bail, et je vais vous la raconter car, comme dit précédemment, qu’est-ce qu’on a à perdre ?
1/ Il y a une multitude de burn-outs
Ça, c’est mon avis, mais c’est aussi un constat : on peine à clairement définir le bail donc chacun·e y va de sa petite sauce. Là où en est le consensus, à date, c’est que c’est PAS une maladie. Pour le reste, on n’est pas méga-avancés, voyez par vous-mêmes.
1/ Les définitions officielles (mon mari)
Côté OMS, on le définit comme un “phénomène lié au travail”, et plus précisément “un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Il se caractérise par trois dimensions : un sentiment d'épuisement ou de fatigue ; une distance mentale accrue par rapport à son travail, ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés à son travail ; et une efficacité professionnelle réduite.”
Ce qui est… descriptif mais pas explicatif, si vous voyez ce que je veux dire. C’est à la fois clair et assez flou. Pas de notion d’échelle, d’intensité : on sent que c’est le bout d’un chemin et que ce chemin est merdique, mais on sait pas trop où il commence et où il s’arrête.
Essayons avec la Haute Autorité de Santé, qui définit le “syndrome d’épuisement professionnel” (l’équivalent du burn-out) (on a vraiment un talent dans les traductions françaises pour rendre les trucs chiants) comme un “épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel » et nous aligne ensuite les mêmes signes qu’au-dessus.
Ça me fait le même effet que quand je fais défiler un carrousel Insta de self-help qui promet de me donner des grands conseils sur la vie : rien n’est faux, mais rien ne fait crac-boum dans ma tête. Sur la base de ces définitions, impossible de se dire, soi, si on est en burn-out, si on y est pas, ou si on est quand même pas loin d’y être.
Et c’est justement pour ça que les chiffres vont dans tous les sens. Parce que la définition est finalement assez peu claire, les estimations du nombre de personnes concernées à un temps T en France vont de… 400 000 selon la police (les professionnel·les de santé) à 2,5 millions selon les organisateurs (les gens, en déclaratif). Ce qui n’est pas pareil, et qui nous montre bien qu’on est un peu paumax.
2/ Casser les burn-outs
Bon, j’ai beau avoir l’audace d’ouvrir ma gueule sur le sujet, j’aurai pas celle de vous proposer une définition en quelques lignes.
Ce que je peux vous dire pour commencer, c’est que je trouve vachement plus d’intérêt au terme anglais. Le “burn-out”, c’est le feu. Littéralement, je veux dire. Le mot porte en lui une idée limpide et sensorielle, celle de la surchauffe. De la combustion. De la carbonisation. Du cramage, qui ne se rapporte pas au plumage.
Et si je préfère le mot “burn-out” c’est que la surchauffe évoque un aspect essentiel, qu’on peine à traduire en français (attention, hot take) : ce n’est pas juste un résultat, ni même juste un état, c’est un process.
Vous connaissez évidemment la fameuse métaphore de la grenouille qui s’échappe quand on la fout dans l’eau bouillante, mais qui reste jusqu’à clamser si on monte très progressivement la température ? Ben autant on n’en peut plus de cette image, autant le burn-out, c’est EXACTEMENT ÇA. Un process, et un process lent, dont on n’a globalement pas totalement conscience jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
OUI MAIS, on va me répondre, et autant en parler tout de suite : il y a burn-out et burn-out non ? Il y a “crises de larmes, fatigue existentielle, insomnies” et il y a “ne pas réussir à se lever un matin et ne pas sortir du lit pendant 6 mois”. Le second, ça serait le “vrai burn-out”. Le premier… non.
Et c’est là que je vais m’énerver toute seule alors qu’on m’a rien demandé.
3/ Le problème avec l’idée du “vrai burn-out”
Voilà, je suis énervée.
Parce que cette idée qu’il y a un “vrai burn-out”, elle me donne de l’urticaire. Qu’on s’entende, ce dont on se parle, quand on parle de ces dépressions sévères, du corps et de l’esprit qui lâchent complètement, de ces personnes qui mettent des mois, voire des années à se remettre (voire ne se remettent jamais totalement), c’est bel et bien un burn-out. Et c’est absolument terrible et dramatique. Et si vous avez traversé ça ou le traversez, sachez que ça me rend triste, que ça me met en rage, que c’est injuste, et que je vous souhaite vraiment fort fort de vous préserver, de vous reconstruire, de vous relever et de ne jamais revivre ça.
Mais.
MAIS.
Mais dès qu’on essaye de distinguer le “vrai burn-out” ci-dessus de toutes les autres formes… on persiste à le faire exister. Parce qu’on donne du carburant à ce qui est le MOTEUR du burn-out : le déni, cette idée que si on arrive toujours à se lever le matin, à être vaguement fonctionnel·le, alors c’est pas si grave, pas si terrible, qu’on n’est pas '“vraiment en burn-out” et donc qu’on n’est pas encore légitime à s’arrêter.
En continuant à croire qu’il n’y a qu’un seul “vrai burn-out”, on continue à croire qu’on a besoin de s’écraser de façon VRAIMENT spectaculaire, et physique, pour s’autoriser à prendre en compte notre souffrance. Tant que ça reste “dans la tête” (et oui bon, aussi un peu dans le corps) (mais de façon supportable, ou du moins d’une façon qui ne nous empêche pas de nous lever le matin) alors ça ne mérite pas qu’on s’y penche et qu’on le prenne au sérieux. On risquerait de passer (auprès de qui ? on sait pas) (d’abord soi-même je pense) pour des chochottes, ça va “on n’est pas à la mine non plus”, bla bla bla.
Je parie que vous êtes relativement d’accord avec ce constat. Moi aussi je suis d’accord avec moi-même. Alors POURQUOI, je vous le demande et je me le demande, si on sait bien que c’est de la merde… on y souscrit quand même ? Moi la première : je harcèle mes potes pour qu’iels se protègent quand je les sens on the road to craquage, mais quand il s’agit de moi… oh, ça va, c’est bon, quelques bonnes nuits de sommeil et ça passera.
Eh bien je pense que si on y souscrit quand même, c’est notamment à cause de cette idée qu’il y a un “vrai burn-out”. Parce que tant qu’on n’osera pas donner un nom qui fait tout aussi peur à TOUT CE QUI PRÉCÈDE le “vrai burn-out”, on continuera de laisser la température monter progressivement jusqu’à ce qu’il soit vraiment, vraiment trop tard. Et on s’assurera ainsi que le “vrai burn-out” continue de vivre sa meilleure vie.
4/ Ce que je propose
Il y a donc deux options :
Option 1 : on trouve un nom pour tout ce qui précède le maxi-craquage, mais un nom qui fait aussi maxi-peur, histoire qu’on mesure bien que ça mérite qu’on y prête maxi-attention. M’est avis que, vu le temps qu’on a mis pour laisser le terme “burn-out” entrer dans les conversations, on est parti pour que ce nouveau terme soit pris au sérieux d’ici Q4 2032.
Option 2 : on appelle tout le reste “burn-out” aussi. Vous l’aurez deviné, c’est la voie que je décide d’emprunter à pleine balle.
Et donc, cet article est un plaidoyer pour qu’on appelle burn-out des choses qu’on a tendance à minimiser ou à catégoriser autrement aujourd’hui. Ces choses incluent :
Le “bébé burn-out” : ça c’est une expression que j’ai, perso, employée pour désigner mes propres burn-outs, avant de découvrir que j’étais pas la seule à l’utiliser. Cette expression elle dit en gros, en s’excusant à moitié, “oui bon, j’ai craqué, mais pas trop, j’ai juste eu besoin d’un petit arrêt maladie tout choupinou de quelques semaines, ça compte pas vraiment”. Je fais le vœu ici et maintenant de cesser de minimiser ce type de craquage, parce que 1/ il contribue à faire du fameux “vrai burn-out” un fait de gloire alors que 2/ attention, je vais patiner sur le verglas de la nuance… en vrai, c’est plutôt l’inverse. J’ai souvent mis mes “mini burn-outs” sur le compte de ma plus grande fragilité/sensibilité, et, clairement, il y a de ça hein. J’ai perso assez peu de résistance au stress (ce qui est problématique quand on est une personne de nature stressée depuis l’enfance, je ne vous le fais pas dire), à la fatigue et à des rythmes élevés. Mais j’ai aussi, par la force des choses vu que je suis une grosse fragile… développé ma capacité à écouter les alertes de mon corps et de mon cerveau en carton. Alors, pas assez, on est bien d’accord (sinon je me serais arrêtée au premier vrillage au lieu de lancer une collec). Mais… les craquages spectaculaires, je les ai plutôt vus chez des gens justement très résistants, capables d’ignorer LONGTEMPS les signaux de leur corps au point de tirer vraiment trop sur la corde. Craquer avant parce qu’on s’écoute un peu, dans l’idéal, il faudrait éviter hein, mais ce n’est pas “bébé”… c’est plutôt assez adulte.
Les gros soucis de santé, NOTAMMENT GASTRIQUES. Il a été étudié que, parmi les symptômes somatiques de l’épuisement pro, il y avait un certain nombre de trucs au niveau du bide (douleurs, nausées, ballonnements, indigestion, constipation ou l’inverse) (je ne vous fais pas le bail sur l’intestin deuxième cerveau, on s’est déjà offert la grenouille qui bout en termes de clichés) et ailleurs (troubles articulaires, troubles du sommeil, vertiges, fatigue, etc. etc.). Ils sont généralement des signaux d’alerte assez à même de prédire un craquage imminent. Eh bien voilà, dans mon petit baromètre Ipsauce x Absolument Aucune Donnée Scientifique, moi j’ai observé un truc : chez les gens dont le psychisme est extrêmement résistant, c’est d’abord le corps qui lâche. Et donc, je fais ici un PFAQ, un Plaidoyer Fondé sur Absolument Queud pour que, quand une personne surmenée au taf fait, au choix, un ulcère/une péritonite/des coliques/des crises hypertensives/un infarctus/un AVC/des syncopes/de l’asthme/des problèmes de thyroïde/du diabète et compagnie… ON APPELLE ÇA UN BURN-OUT. Notamment parce que les gens qui encaissent dans leur tête au point que ça soit leur corps qui lâche, généralement, s’appliquent VACHEMENT FORT à voir le problème de santé en question comme JUSTE un problème de santé, et à ne SURTOUT PAS faire le lien avec leur charge de travail. Donc voilà, commencer par étiqueter ça comme un burn-out, je pense que ça peut aider des gens à, peut-être, un jour, réaliser qu’il est peut-être temps de freiner un coup.
Le vrillage émotionnel : parmi les signes identifiés d’épuisement menant au craquage, il y a la “dérégulation émotionnelle”. Le truc qui fait qu’on n’arrive plus à contrôler ou moduler ses émotions. On devient maxi-irritable ou maxi-triste pour des broutilles, on surréagit, on n’arrive pas à se calmer, on ne se reconnaît plus. Ben pardon, mais de la part d’une meuf qui s’est mise à chialer dans un train parce qu’il y avait des problèmes de réseau, je vous le dis, MOI J’AIMERAIS BIEN QU’ON APPELLE ÇA UN BURN-OUT également.
Le vrillage mental : dans la catégorie “puisque c’est pas physique c’est pas vraiment grave”, les nominés sont… “la dérégulation cognitive”, le “brouillard mental” et la “distance mentale”. Le cerveau qui commence doucement à dysfonctionner (mais bon, pourquoi s’inquiéter, c’est dans la tête). On a du mal à se concentrer, on doit forcer pour réfléchir à des choses simples. On a du mal à prioriser, tout devient urgent, et grave. Et quand tout semble dramatique et important, la défense du cerveau face à la saturation de sa RAM c’est… de décrocher. Soudain, tout devient un peu flou, manque un peu de sens, on devient cynique ou indifférent, on vit un peu en pilote automatique. Vous me voyez venir. L’erreur 404 du cerveau, ce moment soit de surcharge soit de vide total… EH BIEN OUI, JE VOUDRAIS QU’ON APPELLE ÇA UN BURN-OUT, MERCI.
J’arrête ici, car vous avez l’idée. L’idée, c’est que si on réserve le mot “burn-out” au moment où on en arrive à un état irréparable, on ne peut pas faire ce qui est pourtant le plus important dans cette histoire : de la prévention. Ce que j’aimerais, moi, c’est qu’on foute à la poubelle toutes les hiérarchies du craquage et qu’on prenne tous ces problèmes pour ce qu’ils sont : DES CHOSES EXTRÊMEMENT GRAVES. Des alertes hautement inquiétantes, et surtout, des trucs que, dans un monde idéal, on ne laisserait pas nos corps et nos esprits subir à cause de cette chose pas si importante qu’est le travail.
Arrêtons de débattre de la température de l’eau, et mettons-nous d’accord sur un point : si l’eau est chaude, c’est qu’il y a un problème, point. Cessons d’avoir peur du mot et commençons à avoir sérieusement peur de la chose. S’il y a bien un truc que nous ont appris Harry Potter et le fascisme aux États-Unis, c’est que si on met tous nos efforts à éviter de nommer les trucs, on se maintient dans le déni de la capacité des trucs à nous faire du mal.
5/ Si vous voulez quelque chose de plus sérieux
Bon, je suis quand même mal à l’aise de vous avoir donné mon avis de meuf qui n’y connait que dalle, donc je vais vous donner un outil plus solide : le BAT, pour Burnout Assessment Tool. Un outil à jour, plutôt validé par la street du consensus scientifique, qui permet de repérer les signes de burn-out.
ATTENTION ce n’est pas un quiz “êtes-vous en burn-out ?”, ni un outil de diagnostic. C’est à la fois un outil d’éducation qui permet de comprendre que le burn-out a de multiples facettes (épuisement, distance mentale, déficiences cognitives et émotionnelles), un outil de repérage pour aider les gens à se dire que oui, quelque chose cloche, et aussi un baromètre, parce qu’il peut aider à repérer les tendances et l’évolution du schmilblick.
LE VOICI (si vous le consultez sur votre téléphone, ça devient un BAT mobile)
Si vous n’allez pas top en ce moment (déjà je vous envoie vraiment du fond du cœur toute mon affection), je vous le dis tout de suite : ne vous attendez pas à y trouver une “validation” de votre état. Il n’y a pas de seuil à partir duquel on peut dire “là c’est good je suis bien légitime à dire que je souffre”. Car la seule prise en compte de votre état qui vaille… c’est la vôtre. C’est l’autorisation que vous vous donnez à considérer que c’est grave, et à comprendre que vous méritez de vous arrêter. Maintenant. Pas quand vous lâcherez définitivement la rampe. Donc si vous vous retrouvez à cocher vachement de trucs sur la droite du questionnaire, eh bien j’espère fort fort que ça vous motivera à activer le plan ORSEC de préservation de vous-même. Le travail ne mérite pas que vous vous abîmiez. Vos clients, vos boss, les actionnaires de votre boîte ne méritent pas que vous vous abîmiez. Vos proches méritent que vous vous protégiez. Vous méritez de ne pas douiller.
Oki doki, je viens d’aligner 5 sous-parties mais j’en ai encore sous la pédale pour finir de dégommer une bonne fois pour toutes les mythes autour du bousin. Et on arrive sur un autre sujet très très important qui mérite sa partie.
2/ Le burn-out ce n’est pas juste avoir trop de travail
Vraiment pas. Et je pense que c’est aussi parce qu’on comprend mal les causes du burn-out qu’on a du mal à se sentir légitime à le nommer quand on le vit. Donc voilà, ça va mieux en le disant : ON PEUT ÊTRE EN BURN-OUT MÊME SI ON N’EST PAS SURCHARGÉ·E DE TAF. Et à propos d’aller mieux, moi ça va grave mieux dans cette partie, parce que je peux enfin m’appuyer sur le travail d’autres gens pour affirmer des trucs.
Car il existe un modèle, qui s’appelle le JD-R (aucun rapport avec les dés mais ça peut vraiment aider), qui est une sorte de prisme explicatif extrêmement éclairant et très utilisé pour expliquer ce qui mène au burn-out. Le JD-R, ou “Job Demands-Resources”, ou “Exigences-Ressources au travail”, c’est très simple : en gros, chaque job possède ses propres caractéristiques, que l’on peut diviser en deux catégories :
Les exigences : les efforts requis par le job, qu’ils soient physiques, psychologiques, sociaux, organisationnels, qui occasionnent des coûts physiologiques ou mentaux soutenus. Par exemple, au choix : charge de taf, deadlines réduites, conflits, environnement bruyant, complexité des tâches…
Les ressources : tous les aspects qui réduisent les exigences pré-citées, aident à remplir les objectifs ou à se développer. Elles peuvent être personnelles comme organisationnelles. Par exemple : des opportunités, de la formation, de la clarté, de l’autonomie, du feedback constructif, la sécurité de l’emploi, le sens…
En bref, les ressources c’est le carburant, les exigences c’est ce qui crame le carburant. Et en gros, le burn-out survient quand les exigences du travail sont durablement élevées, et que les ressources disponibles pour y faire face sont insuffisantes. La charge de travail c’est l’un des éléments de l’un des deux aspects, ET DONC clairement pas la seule explication. En prime, le JD-R montre que tout ça fonctionne dans un cercle vicieux (ils appellent ça “loss spiral”) : quand on est à plat parce que nos ressources s’épuisent, on n’arrive plus à mobiliser ce qu’il nous reste comme ressources, ce qui fait que les exigences paraissent encore plus grandes, et ainsi de suite.
CE QUI EXPLIQUE, NOTAMMENT :
Pourquoi deux personnes exposées à la même charge de taf peuvent ne pas DU TOUT aller aussi bien/mal l’une que l’autre. Et voilà je m’énerve : QUE JE N’ENTENDE DONC PLUS JAMAIS UNE COMPARAISON ENTRE DEUX PERSONNES POUR REMETTRE EN QUESTION LE BURN-OUT DE L’UNE MERCI.
Pourquoi les idées type “atelier pour apprendre à gérer son stress” sont une réponse insuffisante et partielle au problème.
Pourquoi le sujet du burn-out n’est (et voilà je me ré-énerve) ÉVIDEMMENT PAS DU TOUT UNE PROBLÉMATIQUE INDIVIDUELLE ET PAS DU TOUT LA FAUTE D’UNE PERSONNE.
Pourquoi la phrase “Dis-nous ce qu’on peut faire pour t’aider” rend dingo : car elle transforme ce qui devrait être une ressource en exigence supplémentaire, à un moment où justement, on subit trop d’exigences et on manque de ressources.
Je me calme car on n’a pas fini. Je vais tenter, histoire de BIEN BIEN finir de clarifier le bousin, de vous catégoriser quelques grandes causes du burn-out, dans un mix entre l’analyse des facteurs de risques psycho-sociaux et les études des facteurs du déséquilibre dans le modèle JD-R.
1/ La charge/l’intensité du travail
Je vous le mets par honnêteté intellectuelle, mais j’ai même pas besoin de vous l’expliquer en longueur, on connaît : surcharge, pression temporelle, urgences permanentes, interruptions… J’insiste cela dit sur l’un des éléments de la liste qu’on sous-estime : le morcellement du travail. Le fait non seulement de réaliser PLÉTHORE de tâches dans une même journée, mais que ces tâches soient souvent un tout petit bout du produit fini, ce qui fait perdre au passage le sens et la vision de l’objectif du taf qu’on réalise.
Enfin bon, vous voyez, passons au reste.
2/ Les exigences émotionnelles
Ça tombe bien, j’en ai fait UN ARTICLE ENTIER (et j’en parle dans le bouquin) (Raison n°7 : “Pas d’souci”) (#promo). En gros, c’est devoir encaisser la détresse des autres (coucou les managers, coucou les RH, coucou les professions de soin, coucou les agent·es des services publics) ou la colère des autres (coucou les gens qui sont au contact de la clientèle, qui ont des boss colériques, tiens, coucou à nouveau les agent·es des services publics) ou devoir faire bonne figure même quand ça va pas, voire que d’avoir l’air souriant·e, empathique ou sympathique fait partie du taf. Une charge extrêmement lourde, épuisante, et extrêmement sous-estimée (NOTAMMENT CHEZ LES MEUFS PARCE QUE T’SÉ, C’EST NATUREL CHEZ LES MEUFS ÇA DEMANDE PAS D’EFFORT C’EST BIEN CONNU).
3/ Le manque d’autonomie
Ça c’est d’avoir un faible contrôle sur son travail (j’en parle dans l’article sur la souffrance au travail, quand je fais une comparaison avec le BDSM), de se faire imposer des décisions sans que son avis soit pris en compte, de ne pas pouvoir organiser son temps, de ne pas pouvoir dire “non”. Étrangement, à une époque où on est censé·es tous·tes devenir “entrepreneur·ses de soi” (ouais je cite du Foucault si je veux) (pas Jean-Pierre), on a de moins en moins de contrôle sur ce qu’on fait au taf (la “task discretion”). Dans l’article pré-cité, je parlais d’une étude britannique sur 40 ans qui montrait que, si en 1992, 62 % des travailleur·ses considéraient avoir une “task discretion” élevée, c’était tombé à 34 % en 2024.
Et bon, c’est pas dans les analyses des RPS, mais moi, à ce manque d’autonomie, j’ajoute le micro-management et… le macro-management (OMG JE VIENS D’INVENTER UN CONCEPT) (WOW ÇA FAIT 5 ANS QUE JE RÊVE D’INVENTER UN CONCEPT) (bon, j’ai googlé, le mot existe) (MAIS il est utilisé pour désigner… l’opposé du micro-management) (alors que c’est pas ça que j’ai en tête) (voilà ce que j’ai en tête) : le fait qu’on est aussi, par les temps qui courent, absolument tous·tes soumis·es à des forces 1/ lointaines 2/ qui nous dépassent et sur lesquelles on n’a absolument aucun pouvoir 3/ alors qu’elles ont un impact direct sur nous et notre taf. Ces forces vont de la fameuse “décision groupe” ou même la “décision du fonds souverain qui possède le groupe qui possède la boîte” aux… humeurs de Donald Trump.
4/ Les conflits et les rapports sociaux dégradés
Ça, c’est assez intéressant, parce que ça inclut “mal s’entendre avec les collègues et la hiérarchie” et la violence des rapports mais pas que. Ça implique aussi manquer de perspectives de carrière, se voir confier des tâches qui ne nous correspondent pas (et pas seulement parce qu’on ne les apprécie pas, mais aussi parce que, par exemple, un handicap les rend compliquées), manquer de reconnaissance et… de “soutien social”. En fait, en gros, c’est l’isolement, le manque de collectif et les entreprises qui n’offrent pas un contexte favorable au bien-être.
5/ Les conflits de valeurs et l’injustice
Ça aussi j’en ai fait un article entier, le plus long de l’histoire de CDLT, ce qui est une perf. Ça renvoie au fait d’effectuer un taf ou des tâches qui entrent en collision avec ses valeurs personnelles, professionnelles ou sociales. Ça va évidemment jusqu’à “bosser pour un pétrolier alors qu’on est écolo”, mais c’est pas aussi blanc/noir que ça, ça peut aussi être : faire un taf qu’on trouve inutile (cf. les Bullshit Jobs de Graeber), promouvoir un produit auquel on ne croit pas ou dont on sait qu’il est inefficace, ou ne pas être en mesure de faire un taf de qualité.
Ça semble un gros caprice hein ? J’entends d’ici des gens dire “oh gnagna les petites snowflakes arrivent pas à changer le monde et ça les rend tristounes ?”. Eh bien dans l’article, je parle du concept de “moral injury” : la blessure psychologique, sociale, spirituelle profonde qu’on ressent quand on a dû (et même pour de “bonnes raisons”) agir à l’opposé de ses valeurs et croyances. La “moral injury” a potentiellement des effets dévastateurs : psychiques (culpabilité, honte, perte de confiance), existentiels (perte de sens, cynisme) mentaux (dépression, PTSD) et sur le comportement (retrait social, usage de substances).
Donc non, c’est pas parce que non seulement “c’est dans la tête”, mais qu’en plus c’est une question de valeurs morales, que c’est pas GRAVE.
Dans cette partie, il est important aussi de parler d’une autre valeur qui peut être bafouée par le taf : le besoin de justice. Dans un environnement où les décisions sont arbitraires, les règles floues, où il y a du favoritisme et des injustices (de type, certaines personnes sont promues bien que pas plus compétentes because elles sont fortes à se faire bien voir, voler le taf des autres, lécher des fiaks ou juste à être nées privilégiées), le sentiment d’inéquité peut faire (à juste titre) complètement vriller.
6/ L’insécurité
Évidemment, là on se parle de l’insécurité socio-économique (peur de perdre son taf, contrats précaires) mais aussi, et c’est important, du risque de changement de ses conditions de travail sans qu’on puisse y faire quelque chose : une restructuration annoncée, une stratégie d’entreprise et des objectifs mouvants, ou tout bonnement l’incertitude sur l’avenir de son mériter (COUCOU L’IA).
7/ ALORS
Cette petite liste, elle est pas un peu éclairante ? Pour moi, elle sert à trois choses.
La première, au risque de me répéter, c’est à comprendre que le burn-out ce n’est pas simplement dû à une charge de taf élevée. Il est VRAIMENT IMPORTANT qu’on se sorte collectivement cette idée de la tête.
La deuxième, c’est, si vous, là tout de suite, ça ne va pas ouf au taf (encore une fois, je suis avec vous et je pense à vous, fort), de vous aider à comprendre que ce n’est pas parce que vous êtes une chochotte, un peu trop fragile, ou que vous ne savez pas tenir le rythme. Vous avez des raisons objectives, nombreuses et légitimes de ne pas aller top, vous n’êtes PAS en train de faire un caprice.
La troisième… c’est que cette petite liste c’est… un peu notre vie au taf aujourd’hui, en fait ou je rêve ? Si là, vous, en lisant, vous vous êtes dit qu’AUCUN de ces facteurs de risque ne vous concerne au travail, eh bien je vous invite à faire une micro-pause et à savourer. Car c’est rare, et il faut vraiment vraiment en profiter. Mais… oh merde je vais encore m’énerver. Bon, je saute un paragraphe parce que je sens que y’a du matos.
À TOUS CES GENS QUI DISENT “OH LÀ LÀ LES GENS SONT DES GROS FRAGILES, Y’AVAIT PAS AUTANT DE BURN-OUTS AVANT” j’ai plusieurs trucs à répondre.
Le premier truc, c’est : ah bon ? Qu’est-ce vous en savez ? C’est comme le Covid : tant qu’on savait pas ce que c’était et qu’on pouvait pas le tester… ben y’avait pas de Covid. Autant le terme “burn-out” est apparu dans la littérature scientifique dans les années 70, autant, je sais pas vous, mais je n’en ai pas entendu vraiment parler avant quoi… les années 2010 ? Comment on pouvait savoir s’il y en avait si on ne le mesurait pas (et qu’on est toujours un peu en rade de capacités à le mesurer) ? Comment on pouvait savoir s’il y en avait alors qu’il était encore plus tabou qu’aujourd’hui de parler de santé mentale ? Ce qu’à travers les décennies on a appelé “surmenage”, “dépression nerveuse”, “épuisement nerveux”, “troubles nerveux”, “troubles psychosomatiques”, “craquage”, “être trop sensible”, “ne pas être fait·e pour ce job”… ben ouais, c’était des tâtonnements vers le concept de burn-out.
ENSUITE, LE DEUXIÈME TRUC C’EST : EST-CE QUE LES GENS SONT DES FRAGILES OU EST-CE QUE LE MONDE C’EST DE LA MERDE ? Si on reprend la petite liste ci-dessus (intensité, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, isolement, conflits de valeurs, injustice, insécurité), une chose est frappante : ce ne sont pas des bugs, ce sont des caractéristiques centrales du travail contemporain, devenu plus violent et incertain sous les coups de boutoir du néolibéralisme et plus angoissant dans un monde flippant. Se sentir au bout du scotch aujourd’hui n’est pas une preuve de faiblesse, c’est juste la conséquence logique d’un système qui accumule les exigences tout en asséchant les ressources. Devoir “encaisser” n’est plus “une chose qui arrive quand y’a une merde”, c’est une compétence professionnelle de base. Dire que les gens sont “plus fragiles” c’est comme regarder une forêt carbonisée en Californie et dire “les arbres sont moins résistants qu’avant”. L’épidémie de burn-out n’est pas le signe qu’on devient des gros·ses fragiles, c’est une RÉACTION LOGIQUE À UN ENVIRONNEMENT PATHOGÈNE.
BORDEL.
Ok il va être temps d’arriver à la fin de l’article, mais il me reste un truc à dire.
3/ Vous, là
Bon, je suis un cordonnier extrêmement mal chaussé sur ce sujet. Parce que, d’une part, j’ai moi-même emprunté la route du craquage à non pas une mais trois reprises (j’ai essayé d’en disséquer le pourquoi dans mon article sur la souffrance au travail). Et d’autre part, parce que je n’ai JAMAIS réussi à faire qu’une personne proche de moi et qui était évidemment à 180 km/h en route vers le pétage de câble accepte de s’arrêter au moment où je lui ai dit de le faire.
Et (outre mes faibles capacités de conviction) je crois qu’il y a une raison à ça : il n’y a que deux choses qui peuvent décider qu’il est temps de mettre un stop à des conditions intenables. La première, c’est votre corps (mais on a établi que ce n’était pas optimal), la seconde c’est votre tête, à vous. Le seul moment où on décide de se protéger, c’est le moment où soi-même, on décrète que le ratio “état dans lequel je suis”/“truc pour lequel je suis dans cet état” n’est plus équilibré. Le moment où notre état est tellement préoccupant qu’on se retrouve à devoir lâcher le truc qui le cause. C’est difficile. Notamment parce que, plus on tient, et plus on “a tenu”, plus on crée des précédents de ce qu’on “devrait” être capable de supporter.
Donc, je continue mon plaidoyer. À destination de toutes les personnes qui ont lu cet article et se sont reconnues. Je ne vais pas vous dire quoi faire (ça ne marche pas, c’est à vous de décider quoi faire), je vais simplement vous poser des questions. Elles risquent d’être un peu directes, pardonnez-moi, sachez, au cas où je ne l’ai pas assez dit, que je compatis, et que la situation n’est PAS de votre faute. Je vous parle seulement de la seule chose sur laquelle vous pouvez agir : vous protéger.
Si vous vous dites :
“Ça ira mieux après les vacances / après ce projet / après la réorg / après la prez” : vous avez remarqué comment, quand on est dans cet état, on est toujours tourné·e vers l’avenir ? Alors je vais d’abord vous demander de vous tourner vers le passé : combien de fois, par le passé, avez-vous déjà prononcé cette phrase ? Combien de fois est-ce que cet “après” salvateur a déjà reculé ? Combien de fois, au moment tant attendu, vous avez eu à peine le temps de souffler qu’il y a eu une extension de la deadline, un nouveau projet, une nouvelle urgence, une nouvelle bonne raison de tenir ? Et mauvaise nouvelle : les comptes ne reviennent pas à zéro une fois que la merde est passée. Ces états-là, ils sont cumulatifs. Ce n’est pas parce que vous avez tenu les 5 dernières fois que “là, vous devriez tenir”, c’est justement parce que vous avez tenu les 5 dernières fois qu’il sera plus dur de tenir cette fois-là. Donc, question : est-ce que ça ira vraiment mieux après ?
“J’ai pas tant de boulot que ça, je devrais pouvoir y arriver” / “il y a des gens qui vivent des trucs bien pires” : si vous lisez ça, c’est que vous avez lu le reste de l’article, donc vous savez ce que je vais vous dire. Je n’en peux plus qu’on nous inflige ce concours de teubs de la souffrance. Qu’on nous invite sans cesse à nous comparer, pour minimiser ce que nous, on ressent. Les causes du burn-out sont multiples, et oui, il y aura toujours quelqu’un qui semblera être capable d’endurer plus de choses que vous (autour de vous, dans votre environnement de taf, ou sur LinkedIn). Mais, d’une part, on ne sait rien de ce qui permet à ce quelqu’un de tenir (iel n’a pas les mêmes contraintes que vous dans sa vie / iel est héritier·ère et n’a absolument aucune angoisse de thune / iel dramatise ce qu’iel subit parce que c’est valorisant / iel a une super génétique / iel a des tonnes de soutien), d’autre part on ne sait PAS si ce quelqu’un ne va pas craquer aussi un jour (juste, différemment) et enfin : la seule mesure de votre état qui compte, c’est la vôtre. Le burn-out ne s’évalue pas en comparaison, il s’évalue sur les signaux d’alerte que vous ressentez ET sur la compétence d’un médecin. Et ces signaux sont graves, MÊME s’ils sont dans la tête.
“C’est moi qui ai un problème d’organisation / de gestion du stress” / “je suis juste trop sensible” : ouais, et ce sont les arbres en Californie qui ne sont pas assez ignifugés, la grenouille qui aime trop les bains chauds, les maisons construites sur des failles sismiques qui sont pas assez résistantes, la banquise qui manque de volonté à rester gelée, l’iceberg qui a commis l’erreur de se foutre sur le passage du Titanic et le pneu qui n’est pas assez résilient face au clou.
“Si je m’arrête tout va s’écrouler” / “Je ne peux pas m’arrêter on a besoin de moi” : j’ai plusieurs questions, et j’espère que vous me pardonnerez car elles ne sont pas très sympa. On a absolument tous·tes lu que les personnes les plus sujettes au burn-out sont les personnes avec le plus de conscience professionnelle (chapitre sur Jérémy Cricket) (#promo). Et ça vous honore, mais… Qui est ce “on” qui a besoin de vous, et est-ce que ce “on” est là quand vous avez besoin de lui ? Quels sont les bénéfices de votre travail pour ce “on” et quels sont les bénéfices pour vous ? Attention, j’arrive avec les questions qui piquent vraiment vraiment. Est-ce que le fait que tout risque de s’écrouler si vous lâchez est le signe de votre importance, ou d’une organisation dysfonctionnelle qui fait peser sur vos épaules une charge injuste, dont en prime vous ne retirez pas les bénéfices (à moins que vous ne soyez grassement incentivé·e sur votre taf, ou que vous ayez des parts dans votre boîte, et même là). Et enfin la question maxi-spicy : est-ce que vous ne pouvez vraiment pas vous arrêter maintenant, ou est-ce que vous avez l'impression que vous n'en avez pas le droit tant que vous n'avez pas vraiment maxi-craqué ? Est-ce que vous attendez, inconsciemment, que votre corps prenne la décision à votre place (un malaise, une syncope, une crise de larmes en réunion, une incapacité à se lever le matin) pour avoir enfin une "preuve" indiscutable à fournir ? Et par extension… est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous fait sentir ça ? Un environnement qui vous donne l’impression que vous trahissez si vous vous arrêtez ? Et donc, est-ce que cet environnement qui vous fait vous sentir comme ça mérite que vous vous abîmiez pour lui ?
“Je ne peux pas faire ça aux équipes” : vous savez que les autres vont récupérer votre taf ou que vous allez les abandonner en rase campagne si vous mettez un stop. C’est terrible, parce que vous portez sur vos épaules la responsabilité de pallier un problème organisationnel… avec votre santé. Vous êtes placé·e dans une situation où la solidarité consiste à s’abîmer soi-même pour un peu moins abîmer les autres. C’est injuste, c’est horrible, et ce n’est pas de votre faute. Ce n’est PAS de votre faute. Je vais répéter : ce n’est PAS DE VOTRE FAUTE. En revanche, attention, vous allez détester la question qui suit : vu qu’à un moment ou à un autre, vous allez “faire ça aux équipes”, parce que vous allez craquer, comment est-ce que vous préférez “faire ça aux équipes” ? En vous arrêtant quelques semaines, en étant en mesure de faire savoir les causes de cet arrêt et en soulignant les problèmes qui ont mené là… ou avec un crash qui, en plus de laisser un trou béant pendant des mois aux équipes, fera que les équipes à la fois souffriront de vous voir dans cet état ET se diront que le seul modèle à suivre, c’est le vôtre ? Désolée, c’est cash. Alors je répète : ce n’est PAS de votre faute. Vous protéger, ce n’est pas lâcher les autres, c’est 1/ survivre 2/ lancer un signal pour que les choses changent avant qu’il ne soit trop tard.
“Si je m'arrête maintenant, j'aurai fait tout ça pour rien” : c’est le biais des coûts irrécupérables (sunk cost fallacy, j’en parlais là). Après avoir autant investi et tenu, ça serait du gâchis de s’arrêter là. On a déjà attendu le bus 15 minutes, même si le trajet fait 20 minutes à pied, on va continuer à attendre. C’est humain : quand on est à bout mais qu’on se sent impuissant·e, tout ce qu’il reste c’est de donner du sens à notre souffrance, en se disant qu’au moins, il faut atteindre le but, boucler le projet, finir le truc. Et donc voici ma question désagréable : est-ce que au fond, si votre corps ou votre psychisme sont abîmés irrémédiablement dans ce process, ça aura valu le coup ?
Bref
Le burn-out n’est pas un défaut individuel, un manque de solidité ou de volonté : c’est une réaction logique, quasiment mécanique à un contexte néfaste. La résilience n’est pas une vertu, endurer n’est pas un fait de gloire. Ce n’est pas à vous de changer pour vous adapter au contexte, c’est au contexte de changer pour s’adapter aux gens. Et je suis bien d’accord, ça n’arrivera pas du jour au lendemain, mais ça ne vaut pas le coup de casser les gens en attendant.
Encore une fois : si en lisant tout ça vous avez senti qu’un truc pique, je vous envoie toute ma compassion, et j’espère que vous me pardonnerez d’avoir été un peu directe.
Vous n’avez rien à prouver, ni à vous ni à personne, vous n’avez pas besoin d’aller plus mal pour être légitime. Faites confiance à vos proches qui vous alertent. Faites confiance, aussi, C’EST TRÈS TRÈS IMPORTANT, à l’avis d’un·e professionnel·le de santé. Ce n’est pas vous qui vous “mettez en arrêt”, c’est vous qui allez voir un·e médecin, lui décrivez ce que vous ressentez, et c’est À CETTE PERSONNE DONT C’EST LE MÉTIER d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Ensuite, c’est à vous de les suivre. Les situations semblent souvent insolubles quand on est en plein dedans. On ne répare pas un moteur pendant qu'il tourne à 8000 tours/minute, il faut d’abord couper le contact et laisser refroidir.
JE VOUS DEMANDE S’IL VOUS PLAÎT DE VOUS PROTÉGER. Si ça ne va pas, je vous supplie d’aller voir un·e médecin et/ou un·e psy. Si ça va mal de façon extrême, appelez le 3114 (Numéro national de prévention du suicide) ou le 0 800 858 858 (Croix-Rouge écoute). Il y a une lumière au bout du tunnel, il y a un mieux après, je vous le promets. Plus vite vous prenez les mesures pour vous protéger, et plus ce “mieux” est proche.
Faites attention à vous, S’IL VOUS PLAÎT.
CDLT,
Sev