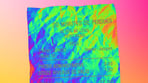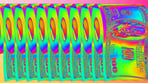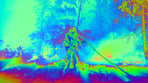Faut-il vendre son âme pour gagner sa vie ?
Salut c'est Franck Leboeuf, vous voulez savoir combien vaut votre âme ?


🎙️ POINT PODCAST : grave envie de consommer le contenu ci-dessous mais
- le rythme épileptique de la vie et/ou
- une vue qui baisse que vous persistez à nier car le besoin de lunettes vous rappelle à votre propre mortalité et/ou
- la flemme
vous empêchent de rester rivé·e à un écran pour lire un article de 15 min de temps de lecture ?
COMME JE VOUS COMPRENDS. Vous trouverez la version podcast, agrémentée d’effets sonores à la con, sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer.
🤖 POINT PUB : oui, watch me, maintenant je fais de la pub sur CDLT. Est-ce que c’est pas le MEILLEUR article pour commencer quand on y pense ?
Et on va parler Intelligence Artificielle. Perso j’ai un peu le même rapport à l’IA qu’à la fonction “itinéraire” sur Google Maps : d’un côté ma vie est vachement plus simple avec, de l’autre j’ai bien conscience que ça me rend chaque jour un peu plus incapable de me démerder toute seule. La seule diff, c’est qu’a priori personne n’annonce que la fonction “itinéraire” de Google Maps va remplacer nos jobs et éradiquer l’Humanité. Bref.
Pour les gens qui comme moi naviguent dans un paquet d’ambivalences sur le sujet, et essayent de se tenir à jour sur le bail MAIS sans succomber à ceux qui balancent des prophéties apocalyptiques pour vendre leur sauce, Grégory Pouy (de Vlan!) a créé une Masterclass pour les Dirigeant·es, DRH et Managers, qui aide à
- faire le tri entre les mythes et la réalité
- comprendre ce que l’IA fait vraiment à nos métiers et à nos cerveaux
- pour anticiper les transformations qu’on a intérêt à mettre en oeuvre chez soi et dans sa boîte
- et intégrer l’IA avec une stratégie claire
Ce qu’il y a dedans : 6 vidéos courtes et concrètes qui font une synthèse de tous les échanges de Grégory avec des expert·es sur le sujet, et des outils clairs, utiles et applicables. Franchement (ben oui je les ai regardées avant de vous en parler), ça fait du bien un récap d’où on en est, et un peu de recul sur le sujet.
Ce qu’il n’y a PAS dedans : des prophéties apocalyptiques à la con.
Ça coûte combien : 149€, mais en fait si vous utilisez le code “CDLT”, y’a 50€ de réduction dont ça fait 99€ du coup.
Vous voulez plus d’infos ? Revoici le site, mais voici aussi l’article ou Greg en parle, ainsi qu’un petit test qu’il a créé pour mesurer sa résilience face à l’IA. J’aurais appelé ça “résilIAnce” mais ok.
Allez c’est parti pour l’article. C’est particle.
Quand j’ai une idée d’article CDLT, généralement ça s’accompagne de l’une de ces deux émotions :
- l’excitation (quand j’ai la connerie) (là j’écris tout l’article en gloussant)
- l’urgence (quand un truc m’énerve ou compte beaucoup, que je suis en ébullition et que j’ai l’impression de déborder de choses à dire que je sais pas comment les dire) (la réponse est : en 159 000 signes avec 4 parties, 16 sous-parties et 345 sources).
Eh ben là, quand je me suis dit que j’avais envie de parler de cette dissonance cognitive qu’on est un paquet à avoir vécue et à vivre, celle entre nos valeurs et ce qu’on se retrouve à faire parfois pour gagner notre croûte (la version extrême du bail étant “être écolo et bosser pour une entreprise pétrolière”, mais vous savez comme moi qu’il y a fifty shades of grey areas dans cette histoire), j’ai eu une nouvelle émotion : une sorte d’évidence ambivalente.
Un mélange de “MAIS COMMENT ÇA SE FAIT QUE J’EN AIE PAS DÉJÀ PARLÉ EN 4 ANS ET DEMI DE NEWSLETTER ?” et de “ouais enfin, je suis qui pour donner des leçons ?”.
Et en fait, la réponse est dans l’énoncé. J’y pense en permanence, comme beaucoup d’entre vous j’imagine. Mais, contrairement à plein de sujets que j’ai abordés dans CDLT, sur celui-là j’ai pas d’idée arrêtée. Je flotte dans un océan de questions et de nuances sans une seule bouée de certitude à laquelle me raccrocher.
Y’a pas si longtemps, avec quelques proches et après quelques verres, on a improvisé un jeu que je vous recommande pour vos soirées si vous êtes vous aussi une personne cheloue : “est-ce que tu assumerais de bosser pour l’entreprise XX ?”. Il y avait deux facettes à ce jeu qui le rendaient particulièrement rigolo (mais on a multi-établi que les trucs que je trouve rigolos sont pas rigolos pour tout le monde) : 1/ est-ce que tu assumerais de dire que tu bosses pour cette boîte sur le plan des valeurs (là forcément, le sel c’est de balancer les Grands Méchants genre Total, Shein, Monsanto et la SG, mais dans ce cas qu’est-ce qu’on pense d’Orano, Zara, Lactalis et le CIC, et puis aussi de Gleeden, CNews, Smartbox ?) et 2/ est-ce que tu assumerais de dire que tu bosses pour cette boîte sur le plan de l’image sociale (là on peut aller sur William Saurin, Comme J’aime, Carglass, la Pataterie et Wall Street English).
Je recommande parce que (outre la rigolade) c’est l’occasion d’une discussion vachement éclairante, sans pointer rien ni personne du doigt (rapport à ce que c’est fictif), sur les valeurs qu’on prône, l’image qu’on veut projeter, les ajustements qu’on s’autorise, où on en est sur l’idée de pouvoir “changer les choses de l’intérieur”, et les trade-offs qu’on se permet. En vrai c’est pas une excellente question pour un premier date, maintenant que j’y pense ?
Bref, tout ça pour dire que ce sujet me travaille, et que j’écris cet article d’une position de totale vulnérabilité. J’ai un paquet de doutes sur les choix que j’ai faits dans ma vie et ma carrière, les raisons de ces choix et ce qu’ils disent de mes valeurs. J’ai un paquet de doutes sur mes valeurs. J’ai un paquet de doutes tout court. Je n’ai de leçons à donner à personne, mais j’ai aussi du mal à en recevoir. Il y a des actes, des paroles et des idées auxquels je m’oppose viscéralement, mais avant de mettre quelqu’un avec assurance dans la case “énorme connard”, je passe toujours (c’est fatigant d’être dans ma tête) par une tentative, au minimum, de compréhension de ce qui l’a amené là, de son degré de sincérité, de ses ressorts. Je crois fermement qu’expliquer est différent de justifier ET EN MÊME TEMPS je peux pas garantir que je serais capable d’avoir cette magnanimité si on faisait du mal à quelqu’un que j’aime. J’admire énormément les personnes qui ont des valeurs fortes et vivent en accord avec, mais je ne suis pas toujours sûre que ce que ça implique (si on est jusqu’au-boutiste, généralement : s’extraire de la société et/ou pointer les autres du doigt) fasse avancer le schmilblick. J’essaie d’être ouverte d’esprit, mais il y a des choses que je persiste à ne pas pouvoir entendre. J’essaie d’avoir un style de vie à peu près en accord avec ce que je crois bon pour la planète et les gens, et je sais très bien que j’y arrive pas, et en même temps je crois que la pression à l’action individuelle est injuste et a ses limites, mais je ne sais pas si c’est pas une excuse que je trouve à mes manquements. Je suis douloureusement consciente de tous les ajustements que j’ai faits au fil de ma vie avec ce en quoi je croyais quand j’avais 18 ans. Je me souviens (surtout pendant mes insomnies évids) de chacune des fois dans ma vie où j’aurais pu agir face à une situation injuste et je ne l’ai pas fait. Je tente d’être consciente de la position de privilège qui est la mienne. Je ne sais pas toujours où est la ligne entre la nuance et le relativisme.
Bref, j’suis perdue. Et vous ça va ?
Je m’avance, mais j’ai comme l’impression qu’on est beaucoup à barboter dans ce bourbier.
Alors ce que je vais faire dans cet article (car croyez-le ou pas, on en est encore à l’intro), c’est parler de l’écart entre nos actions et nos valeurs dans le cadre de du travail. Mais sans aller vers un but, sans démontrer un argument, juste en essayant, le plus honnêtement possible, de poser les termes du débat, de mes doutes, de mes questions et de ce que je ressens au niveau de mes tripes.
En gros, je vous embarque en road tripes.
C’est quoi déjà, vendre son âme ?
Parce qu’il Faust commencer par le commencement, séquence définitions. Évidemment, nos valeurs et nos actions sont éminemment personnelles. Quels que soient les exemples que j’ai pris et que je vais prendre par la suite, ils ne sont pas universels, et ne prétendent à aucune vérité absolue (même si bon, vous verrez, quand même un peu à un moment). Alors tout ce que je peux dire, c’est que dans le travail, ce qu’on appelle couramment “vendre son âme”, c’est à peu près : consentir de façon répétée à réaliser, soutenir ou laisser passer des actions qu’on juge contraires à ses valeurs fondamentales en échange d’un avantage, au point de ressentir une atteinte durable à son intégrité.
C’est bien ça, ça fait pro, mais c’est beaucoup trop riche. Donc on va déplier tout ça.
Perspective historique
À l’origine, quand on vendait son âme, c’était au Diable, et c’était en échange de faveurs de type jeunesse, beauté, savoir, richesse, renommée, pouvoir, bonheur. Aujourd’hui le Diable c’est le Capitalisme, et la vente est littérale puisque c’est souvent en échange d’argent rapport à payer le loyer. Voilà, rondement mené, j’ai traîné sur l’intro mais là on a clairement passé la première.
Perspective philosophique
Je ne vais pas résister à faire une partie philo sans vous envoyer un bon gros “de tout temps” bien baveux.
Car, le saviez-vous, on a un peu toujours été des nullos. Socrate, qui n’en pouvait plus de voir des gens de gauche utiliser Amazon et Deliveroo, a plus ou moins été le prem’s à penser l’acrasie (oui) (à ne pas confondre avec l’acratie merci) : la tendance des gens à agir à l’encontre de leur meilleur jugement. Et parce qu’il avait de l’affection pour ses potos du 19e arrondissement qui adorent Poutou mais ont un abonnement Prime, il a essayé de leur trouver des excuses, en disant en gros (on appelle ça la thèse “intellectualiste”) que c’est probablement parce qu’iels avaient pas toutes les infos, donc en vrai, la vraie acrasie n’existe pas puisqu’ils SAVAIENT PAS. Ce à quoi Aristote, qui a aussi de l’affection pour la gauche œufs de lompe, mais moins, rétorque que non, en fait, on peut vraiment SAVOIR et quand même faire de la merde, c’est humain.
J’espère que vous avez vos sacs à vomito car on va faire une fat accélération, et passer direct à Marx. En gros fan de Pink Floyd, il éclaire une autre facette du bail, le dark side of the moon de “vendre son âme”, avec le concept d’aliénation : le fait, pour l’ouvrier dans le système capitaliste, d’être dépossédé du sens et des fins de son activité. Y’a quatre couleurs dans le spectre de l’aliénation : être aliéné du produit de son travail (qu’on ne possède pas), de son activité elle-même (par des gestes imposés et répétitifs), de son “être générique” (devoir trahir sa nature créatrice) et enfin de ses semblables (la compétition ayant remplacé la coopération). En gros, en bossant, le travailleur/la travailleuse vend sa force de travail comme une marchandise, et perd le contrôle sur ce qui devrait être l’expression de sa nature humaine, ce qui au final l’appauvrit spirituellement et matériellement. Un peu “vendre son âme” quoi.
Et on va terminer ce tête-à-queue sans queue ni tête par un peu de XXᵉ siècle pour ajouter juste ce qu’il faut de gris dans les cinquante nuances. Si on continue sur l’évolution du travail, Max Weber, qui adore Mylène, explique faire partie d’une généraaaation désenchaaantée, le travail moderne étant de plus en plus soumis à la rationalisation, à l’obligation d’efficacité, à des règles impersonnelles et des objectifs calculables. Il décrit un travail rationalisé et bureaucratisé dont le sens se vend à la découpe, où l’on optimise les moyens plutôt que d’interroger les fins. On a clairement perdu l’âme au passage.
Par ailleurs, en termes d’éthique (même s’il l’applique à la vocation politique) il formule une distinction intéressante entre “éthique de conviction” (tenir un principe quoi qu’il en coûte et sans contrefaçon) et “éthique de responsabilité” (répondre des conséquences prévisibles de ses actes et assumer d’être une catin). Pour Weber, être adulte c’est essayer de tenir ensemble les deux, parce qu’à être trop rigide on se décharge forcément des effets de ses décisions, et à être trop flex on lâche peu à peu ses convictions sur l’autel du business-first (c’est évidemment moi qui résume, hein, c’est pas hyper canonique comme formulation).
Arrive la Seconde Guerre mondiale, après laquelle, dans un état d’absolue sidération, on se demande comment des humains, construits à peu près comme nous, peuvent en arriver à commettre des actes d’une atrocité inouïe. Dans le but évidemment d’éviter que ça se reproduise (raté). La boss c’est bien sûr Hannah Arendt, qui formule la “banalité du mal” en couvrant le procès Eichmann, et montre comment le mal extrême peut procéder d’une pensée suspendue, d’une obéissance routinière, d’un zèle bureaucratique plus que d’une volonté démoniaque. Bref, une rengaine qu’on connaît bien dans le tertiaire aujourd’hui (et là vous êtes des gens malins, vous SAVEZ que je ne suis pas en train de comparer littéralement “bosser en fusacq” avec le nazisme, je parle juste d’un dérivé délayé et foncièrement humain de cet abandon de responsabilité) : je ne donne pas les ordres, je ne fais qu’exécuter, si c’est pas moi y’aura quelqu’un d’autre pour le faire.
J’pense que je score pas de ouf au bac avec cette dissert, mais en gros, y’a quand même un peu tout ce qui va nous servir par la suite : un truc foncièrement humain (l’acrasie), une forme du travail qui force à la distance (l’aliénation), des nuances nécessaires (la prise en compte du contexte et des conséquences de nos choix) et notre tendance à parfois suspendre notre jugement et nous justifier par le fait d’être des rouages.
Perspective psychologique
Je fais pas mine de vous apprendre le concept de “dissonance cognitive” car nous sommes en 2025, NOUS VIVONS en dissonance cognitive, c’est comme si je vous expliquais le principe de “respirer de l’air pour pas mourir”. EN REVANCHE, ce que son inventeur, Leon Festinger, a formulé aussi et qu’on connaît moins, ce sont les trois façons dont les humains essaient de réduire l’inconfort que provoque la contradiction entre sa croyance et ses actes :
1/ changer l’acte (arrêter de commander sur Amazon)
2/ changer la croyance (devenir ultralibéral·e)
3/ le plus intéressant : ajouter une histoire qui réduit la dissonance (“ça crée des emplois”). Selon Festinger, plus l’inconfort est fort, et plus la rationalisation devient créative (et si comme moi, vous êtes une personne qui doute énormément de ses propres choix ET qui est très créative, vous savez très bien de quoi il parle).
Je vous fais pas Milgram vu que même France 2 a la ref, en revanche y’a deux autres trucs que je trouve vraiment intéressants.
On va commencer par le travail du psychologue Albert Bandura (et j’m’en fous, dans ma tête j’entends Antonio Banderas et je l’imagine avec un fouet vous pouvez rien y faire). Il a beaucoup étudié les mécanismes du désengagement moral : les trucs qu’on se dit ou qu’on fait face à des actions qu’on a du mal à assumer, pour continuer de se regarder dans le miroir et (vaguement) dormir la nuit. Le premier mécanisme du désengagement moral, c’est “l’étiquetage euphémistique”, tous ces mots cotonneux qu’on utilise pour masquer la violence (si vous avez loupé mon article sur le sujet, sentez-vous libres de prioriser sa lecture si vous avez de la bande passante). Il y a aussi la “comparaison avantageuse” (trouver quelqu’un / une boîte qui fait pire que soi), la “diffusion de la responsabilité” (dont je parle dans l’article sur les mots, et dans cet article de 2023) avec le fameux “on”, mais attendez c’est pas fini, on a aussi le “déplacement de la responsabilité” (“hé, c’est pas nous qui produisons trop de plastique c’est les gens qui recyclent pas”) et la “déshumanisation” (parler des gens comme pas des gens, genre des consommateurs, ou des segments), la “distorsion des conséquences” (de type y’a pas de preuve que ça fait VRAIMENT du mal). Vous aussi, vous trouvez que cette liste elle pique un peu, mais vous en voulez encore ? Il nous reste la “justification morale” (de type la survie de l’entreprise, l’emploi, etc.) et enfin le “dénigrement des gens qui critiquent” qui sont au choix débiles, naïf·ves, trop militant·es ou pas mieux que soi. Franchement, après cette liste éclairante, je ne vois rien à ajouter.
Le dernier concept qui me semble intéressant à aborder avant de prendre la bretelle vers l’autoroute du doute, c’est celui de “moral injury”. Le terme est popularisé en 1994 par le psychiatre Jonathan Shay, qui travaille avec les vétérans du Vietnam. Là, on n’est plus sur une exploration des raisons et des justifications, on parle des conséquences. Ce qu’il appelle “moral injury”, c’est la blessure psychologique, sociale, spirituelle profonde qu’on ressent quand on a dû (et même pour de “bonnes raisons”) agir à l’opposé de ses valeurs et croyances. De la guerre, ça a été étendu aux professions de santé par Talbot & Dean, qui ont exploré les effets sur les soignant·es de ne pas être en mesure (pour des raisons systémiques) d’offrir des soins de qualité. Les effets ? Euh ben… tous. Y’a tous les effets. Des effets psychiques (culpabilité, honte, colère, perte de confiance), des effets sur la santé mentale avec un risque accru de dépression, de PTSD et de comportements suicidaires, des effets sur le comportement (retrait social, usage de substances), des effets existentiels et spirituels (perte de sens, crise morale, cynisme) et des effets sur l’organisation (détresse, désengagement, envie de partir, burnout). De là, même si on ne vit que 0,1 % de ce qu’a vécu un vétéran, l’extension sur ce que ça peut faire à n’importe qui de se lever le matin et de consacrer une grande partie de son temps éveillé à faire quelque chose qui nous débecte, qu’on trouve néfaste, ou qu’au mieux, on sait inutile (je vous épargne aussi les “bullshit jobs” de Graeber, vous voyez) est plutôt évidente.
Bon, on a fini de poser les bases. On arrive sur le nerf de la guerre. Littéralement.
Ce qui est compliqué
Entre le paragraphe précédent et celui-ci, je suis allée à une soirée (encore bon anniv Gab) et j’ai évidemment, parce qu’il n’y a pas de petite recherche de terrain, lancé une discussion avec des gens qui sont comme moi plus ou moins dans le conseil et la stratégie (coucou les gars) sur le thème : les sujets les plus éthiquement douteux sur lesquels on avait bossé. Si j’en crois cette petite étude Iflop x Séverine Bavon sur un échantillon maxi-représentatif, les résultats sont sans appel (à un ami) : il est quasiment impossible, au fil d’une carrière, de ne pas se retrouver confronté·e à des sujets/problématiques/clients de type ténébreux. On a tous·tes fait les gros yeux à un moment de la confession de quelqu’un d’autre, avant de balancer nos propres bails sales et de générer les mêmes gros yeux (si on apprend UN truc avec cet article, j’en ai bien conscience, c’est qu’il ne faut pas m’inviter à des soirées).
Mais voilà, je vous l’ai dit, dans tout ça, dans la façon dont on gère ça, j’ai plus de questions que de réponses. Donc ce que je vais faire, c’est vous faire l’état de mes questions.
Quel tort on cause vraiment ?
Ah ben en fait on ne va pas pouvoir se passer de repasser par la station service des Bullshit Jobs, désolée. Si le concept est devenu si populaire, si vite et de façon si durable, c’est que son auteur, David Graeber, a réussi à mettre le doigt sur un truc de l’époque : beaucoup de gens ont la conviction profonde, intime, que leur job est inutile au point que s’il disparaissait, le monde ne s’en porterait pas plus mal (voire mieux). Plein de gens se lèvent le matin en sachant que leur taf n’a pas d’effet positif sur la société (ni même réellement sur leur entreprise) et probablement… pas d’effet tout court.
Petite déviation juste parce que c’est intéressant, vous pouvez sauter : ce que je trouve passionnant, c’est les causes qu’il invoque. Graeber explique (et c’est un de mes chevaux de bataille donc je ne peux pas ne pas en parler) qu’on a fait un choix politique. On aurait pu, avec les gains de productivité énormes qu’on a faits sur le siècle écoulé, réduire le temps de travail (Keynes prédisait 15 h par semaine, donc imaginez s’il avait connu l’IA), mais on a choisi de préserver le plein-emploi parce qu’on voyait le travail comme un outil d’ordre moral et de paix sociale. Donc au lieu de libérer du temps, on a inventé du travail (reporting, couches intermédiaires, etc.) pour occuper les gens. Ajoutez à ça la bureaucratie qui vient avec toutes ces couches, la rentiérisation (une économie qui se déplace vers l’extraction de rentes type propriété intellectuelle et plateformes, ce qui nécessite des armées de juristes, PR, lobbyistes à la valeur sociale nette assez limitée), la contrainte de la dette (un truc, à l’échelle des foyers comme des organisations, qui force à la discipline et oblige à chercher la stabilité), la féodalité managériale (le truc qui fait qu’on crée des postes pas toujours par besoin, mais pour étendre son fief et donc la mesure de son pouvoir), et le fait que l’économie se centre sur des KPI visibles/mesurables détachés de ce qui apporte de la vraie valeur sociale (entraide, soin, open source). Avouez, ça fait exploser le cerveau un peu.
J’en parle pour 3 raisons. 1/ Parce que c’est intéressant. 2/ Parce que ça raconte comment énormément de jobs en sont venus à être très, très détachés de la finalité de ce que fait l’entreprise, concrètement. On va prendre un exemple particulièrement violent, je vous annonce donc un Trigger Warning : Gaza. Et ça ne sera pas le dernier, donc si vous le sentez pas (ou que vous n’êtes pas prêt·e pour un exercice intellectuel périlleux) je comprends, c’est le moment de passer à la suite de votre journée.
Vous avez forcément vu passer l’info de la recommandation du Boston Consulting Group sur la faisabilité et le coût du déplacement de 500 000 Gazaouis pour réaliser la Gaza Riviera. Tout dans cette histoire est monstrueusement abject, et même moi, je manque de mots pour exprimer à quel point. Je vous renvoie à la tribune de David Naïm sur le sujet.
Maintenant, si vous êtes
Un·e juriste parmi 32 000 employé·es du BCG
Qui fait une repasse legal/compliance sur les PowerPoints
Écrits par un·e consultant·e junior
Briefé·e par un·e consultant·e senior
Qui reporte à un·e partner
Qui présente au partner chez le client (une boîte de sécurité)
Qui le file à son/sa senior
Qui le fait assembler dans une reco globale par son·sa junior
Et checker par d’autres juristes
Avant de le présenter au gouvernement israélien
Qui transmet au commandement militaire qui le transforme en procédures
Transmises au commandement local qui le transforme en ordres
Donnés à un soldat
Qui tire sur des enfants dans un couloir humanitaire lors d’une évacuation,
la terrible et abominable question, la question qui me fait trembler les mains c’est : quel tort avez-vous causé, vous, petit rouage du BCG ? Encore une fois, je ne pose pas la question avec une réponse en tête. J’en ai pas. Je ne peux pas dire “aucun” comme je ne peux pas dire “vous êtes responsable”. Je me retrouve seule face à mon écran avec un vertige abyssal face à une version corporate, processisée et digitalisée de la banalité du mal.
Qui est responsable ?
Ce qui nous amène naturellement à ma raison 3/ d’invoquer les “bullshit jobs”, si vous avez suivi : la dilution de la responsabilité. Dans toute la chaîne que je viens de lister, vous et moi on arrive à mettre le doigt sur le nœud, le maillon central, le commanditaire et l’orchestrateur de l’atrocité. Mais les autres ? Tous·tes les autres ? Tous·tes soumis·es d’une façon ou d’une autre à de la hiérarchie et des contraintes, et pourtant participant activement, apportant un peu plus que de la simple exécution, mais… leur contribution à la cruauté ? Quelle est leur part de responsabilité ? Est-ce que la responsabilité est un absolu, ou des quotas qu’on distribue ?
Là, moi, tout ce qui me reste c’est d’essayer de faire un peu de sens dans ce marasme. Et j’invoque le psychiatre et philosophe Karl Jaspers qui, dans son cycle de conférences sur “la culpabilité allemande” dans la foulée des procès de Nuremberg, essaye justement de formuler un cadre pour inviter chacun·e à examiner sa propre responsabilité dans l’atroce, seul préalable pour lui à une réparation. Il distingue :
La culpabilité criminelle : la violation claire d’une loi, prouvable par les faits, jugée par des tribunaux, avec une sanction juridique.
La culpabilité politique : l’appartenance à une collectivité (État, organisation) dont les actes ont causé un tort. Elle est jugée par l’ordre politique (la communauté internationale, les gagnants). Pour Jaspers, on peut ne rien avoir fait d’illégal et pourtant être responsable politiquement pour des actes commis en notre nom, par l’État ou le collectif auquel on appartient. Notre responsabilité alors est de les examiner, d’accepter les sanctions et d’exiger des transformations.
La culpabilité morale : la responsabilité morale pour ses actions et pour ses omissions. Là, le juge, c’est notre propre conscience.
La culpabilité métaphysique : qui les dépasse toutes, parce qu’elle tient de l’absolu. C’est le devoir envers toute personne souffrante, notre responsabilité humaine vis-à-vis de chaque autre humain. Je sais pas vous, mais ces derniers temps, je vois très bien de quoi il parle.
Ce que je trouve intéressant dans (ce que je comprends de) Jaspers, c’est justement sa façon de tracer une ligne nuancée entre le “tout le monde coupable de tout” et notre tendance naturelle à nous auto-blanchir. Au-delà de la culpabilité criminelle, qui a le mérite d’être (sur le papier en tout cas) plutôt claire, le reste force, dans un monde où les process et les structures empilent et délayent des successions de micro-responsabilités, à faire un exercice inconfortable, qui est de balayer dans son propre jardin d’abord, avant de se lancer dans le jugement de la propreté du jardin du voisin.
Qui peut dire “non” ?
Oui mais.
Oui mais.
Permettez-moi, au cas où je vous aurais pas encore foutu assez le cafard, d’embrayer sur un autre exemple issu de mon petit répertoire personnel de joyeusetés : #metoo (je suis vraiment the life of the party, à dispo pour venir ruiner l’ambiance dans vos sauteries contre menue monnaie). En 2019, je bossais encore dans la pub quand elle a fait son #metoo sectoriel, comme tant d’autres industries gangrenées par l’omerta l’ont fait avant et après (médias, journalisme, cinéma, justice, etc.).
Des femmes d’un courage inouï ont témoigné, balançant des noms et des récits que — comme il se doit dans les secteurs cools, ultra-concurrentiels, fondés sur le gossip mais précaires et non-politisés — absolument tout le monde connaissait déjà, mais qui n’avaient jamais été dits tout haut.
Et je me souviens très, très distinctement d’un truc, sur le Twitter pub à l’époque. Des gens, particulièrement des hommes, en appelaient à PLUS de noms (car quand les premiers sont sortis, on savait qu’il y en avait un gros paquetos en stock). Le message était globalement “Allez-y les zouzs, lâchez les blases, on vous soutiendra, mais il faut donner les noms pour que ça avance”. En gros : partez devant, on vous suit, promis.
Et franchement pour beaucoup, je pense que c’était sincère et plein de bonne volonté.
Mais aujourd’hui — à moins d’être d’extraordinairement mauvaise foi — on a assez de recul sur les dénonciations publiques d’agressions sexuelles et de viols pour savoir comment ça se passe : quand une femme témoigne face à un personnage public, sa vie part en lambeaux. Elle se retrouve soudain prise en tenaille entre des soutiens pleins d’amour et un harcèlement d’une violence inouïe, puis elle se fait broyer par des machines juridiques enclenchées et huilées par la puissance et la thune, et puis quand tout ça s’éteint, que les soutiens comme la haine se tarissent, elles se retrouvent seules avec ce qui reste. Ce qui reste, c’est au mieux les proches, le respect, la gratitude des autres et le fait de savoir qu’on a fait quelque chose de bien. Mais bien souvent, c’est aussi une carrière en gravats, des plaies ouvertes et la violence de voir son agresseur (dont tant déploraient la carrière brisée) devenir ministre, être promu, continuer sa vie avec “juste” quelques nouvelles casseroles au cul. Celles qui le font, qui continuent de le faire, sont héroïques. On vous croit.
Ce que je viens de décrire, c’est la version extrême de “s’élever contre”, bien sûr.
Mais.
Autant, je suis absolument pour l’auto-palpation de sa propre responsabilité et de ses propres moyens d’action face à une situation, autant, je suis mal à l’aise face à l’idée d’inciter les individus à porter sur leurs seules épaules le poids du changement, de l’action juste, de faire des choix impliquant un sacrifice personnel au nom d’un bien supérieur.
Car quoi qu’on en dise, pouvoir dire non est un privilège.
Et la pureté est très souvent un luxe.
Je ne suis pas du tout sûre de ce qui suit, je ne sais pas si c’est de la nuance ou “tout et son contraire” merci de boucler vos ceintures. Mais voilà, a priori ce qui est clair, c’est que c’est plus simple de refuser de bosser pour un Grand Méchant quand on a : un job avec un gros niveau d’employabilité dans un secteur qui recrute, un nom bien français, la peau claire, une teub de naissance avec laquelle on est en accord, pas de handicap, assez cotisé pour avoir le chomdu, un filet de sécurité financier et familial, pas de famille à charge et pas de dettes. Mais le truc (et c’est là où je suis sûre de rien), le truc compliqué, c’est les “golden handcuffs”. Les “golden handcuffs” c’est gagner un salaire mirobolant sur le papier, mais qui part dès le 4 du mois dans un prêt, un loyer, l’école des gamins, une pension alimentaire et tutti quanti, parce qu’on a un niveau de vie exactement au niveau de ce qu’on gagne. Les “golden handcuffs” s’appellent comme ça, car ce salaire élevé rend dépendant de son job, vu que des postes qui payent autant, y’en a pas mille. Une situation que, je crois, beaucoup connaissent, et qui fait qu’on possède techniquement beaucoup… mais qu’on a aussi beaucoup à perdre.
Sauf que, vous me direz, les gens qui ont fait grève, qui ont gueulé, qui ont manifesté, se sont érigés contre des systèmes injustes, celles et ceux qui ont pavé au fil des décennies la voie de notre “modèle social”, n’avaient pas non plus les moyens de leur sacrifice. Et c’est vrai. Les ouvriers et ouvrières qui ont arraché la réduction du temps de travail, le droit de grève, le repos hebdomadaire, la sécu, le SMIC, les retraites ou les congés payés ont payé leurs jours de grève avec de la misère, pour construire l’avenir dont on bénéficie aujourd’hui.
Je crois que la différence (et, pour rappel, je ne cherche pas des excuses, je cherche des clés) c’est le collectif. Diviser pour mieux régner, on n’a pas encore trouvé mieux pour atomiser toute perspective de revendication. D’un monde de syndicats, de condition ouvrière et de caisses de grève, on se retrouve dans un monde de tous tout seuls, chacun·e dans son petit cadre de visio à s’accuser les un·es les autres (c’est la faute aux boomers ! aux consultants ! aux assistés ! aux patrons ! aux immigrés ! aux jeunes ! aux fonctionnaires ! aux startuppers ! aux wokes ! aux élites ! aux incultes !). Qu’on s’entende, moi je pense que c’est carrément la faute à Macron certaines des personnes de cette liste hein. Mais vous aussi, et peut-être pas les mêmes, et tant qu’on s’écharpe à s’entre-pointer du doigt, on fait exactement ce qu’on attend de nous, c’est-à-dire éviter de poser une question essentielle :
Ça serait pas aussi le système qu’est un peu pété ?
Bon, ce qui suit est sans grande surprise, il suffit de lire deux à trois de mes articles pour savoir où je finis toujours par aller.
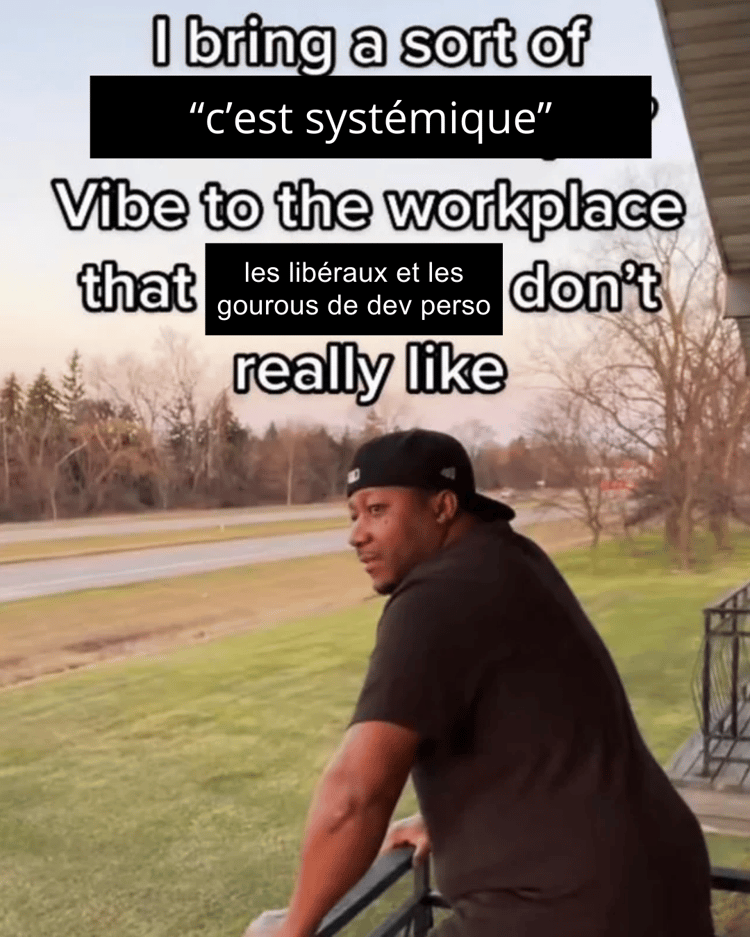
Car au fond, l’intégralité des interrogations que je viens de partager reviennent à poser une seule et même macro-question : celle de la responsabilité individuelle au sein des structures. Quelles sont la responsabilité, la marge d’action, le devoir, et la capacité de transformation d’un individu face aux agissements d’une organisation qui l’emploie/le rémunère ?
Poser cette question, c’est foutre le doigt dans un sac de nœuds où absolument tout est entremêlé.
Les décisions d’une boîte, par exemple “bosser ou non pour packager avantageusement les actes d’un gouvernement génocidaire” (naaaan mais cette histoire du BCG c’est forcément un acte isolé ? Je vous présente Stagwell la dernière en date) sont formulées dans un contexte.
Sauf exceptions (où certaines valeurs sont inscrites non pas dans des slides mais dans le business model), une boîte est par nature foncièrement amorale; pas immorale, pas la mayonnaise, mais a-morale, c’est-à-dire intrinsèquement “dépourvue de morale”. Son seul objectif est : faire de la thune. Il n’y a théoriquement pas d’autre considération à prendre en compte. Donc, si on suit cette logique, un client est un client, qu’il soigne des gens, les transporte, les nourrisse ou les bute. Le seul truc qui peut contrebalancer ça, c’est que choisir ce client puisse, à terme, faire perdre plus de thune que ça n’en fait gagner : ça peut venir du risque réputationnel (= que ça se sache, et que ça fasse fuir d’autres clients), du risque interne (= que ça démotive et fasse fuir les talents existants ou empêche d’en recruter de nouveaux), du risque légal et réglementaire (= les sanctions). Qu’est-ce qui peut amener à le faire quand même, alors ?
Le calcul coût-bénéfice justifie de prendre le risque : on ne fait entrer aucune considération morale, on fait un calcul et on en déduit soit qu’on a plus de chances de sortir gagnant de l’histoire, soit que la situation économique de la boîte nécessite de prendre la décision à court terme, on verra plus tard pour les conséquences.
On s’en fout : que ça soit par conviction personnelle (ce qui a été la défense du BCG, le fameux : “c’est un mouton noir, le cas est isolé, on n’y est pour rien merci de ne pas nous associer à ça”) ou par débilité personnelle, on décide qu’on ne va même pas évaluer les risques et y aller quand même.
Sauf que. Si votre cerveau n’est pas encore devenu une grosse motte de beurre au soleil à ce stade de la lecture (ce qui serait compréhensible), vous vous êtes peut-être dit : ben résultat, les boîtes ne sont pas des agents purement rationnels. Et en effet.
Parce que les boîtes sont faites de gens, qui ne sont pas des agents purement rationnels. Et c’est là que se situe le goulot d’étranglement de la complexité. Car chaque personne impliquée dans le process qui mène à écrire sur des slides “of course this would require actual hostages willing to participate” est un humain, avec des convictions, des valeurs, des incohérences, mais aussi une hiérarchie, mais aussi dont la subsistance dépend potentiellement d’un salaire reçu en fin de mois dans un monde de plus en plus angoissant, et qui pourrait avancer l’une des excuses que j’ai listées au début de cet article, de la diffusion de la responsabilité à la justification morale.
Ce que je veux dire, ce n’est PAS que les personnes qui ont fait ces slides n’ont pas de responsabilité.
Mais dans l’optique où ces gens ne sont pas des monstres (option qui n’est pas totalement à évacuer cependant), la question qui reste à poser c’est : qu’est-ce qui les amène à le faire ?
C’est la question à laquelle se retrouvent confronté·es tous les gens que j’ai cités plus haut. Et la plupart, de Hannah Arendt à Jonathan Shay (le gars de la “moral injury”) en passant par Graeber (le gars des “bullshit jobs”) et Bandura (le psychologue au fouet qui parle du désengagement moral) en arrivent à la même simple conclusion : parce que le système le permet ou le favorise.
“Le système le favorise”, je ne pense pas que ce soit un déplacement de responsabilité.
Parce que pour moi, la responsabilité n’est plus le sujet à ce stade.
Hein ? Il est temps pour un petit stop sur la bande d’arrêt d’urgence. Ça fait 50 kilomètres que je parle responsabilité et soudain ce n’est plus le sujet ? Ouais. Parce que si on se pose deux minutes, écrire un article entier sur le fait de vendre son âme au travail, ne peut, globalement, qu’avoir un de ces deux buts :
pointer du doigt
essayer, à ma microscopique échelle, de faire avancer le schmilblick
Eh bien au cas où il est besoin de le préciser, mon choix se porte sur l’option 2. Je crois fermement qu’on ne peut faire avancer les choses qu’en dépassant le réflexe — pourtant très, très facile à adopter ces temps-ci — de s’entre-critiquer et en mettant notre énergie à nous attaquer collectivement aux riches à ce qui permet à la merde de nous merder dessus.
Hein, quoi, on fait quoi ?
Bah si j’avais pas de réponses fermes avant, j’en aurai pas davantage maintenant.
Les seules choses que je peux vous dire, c’est qu’on pourrait peut-être (à voir) (c’est pas sûr) (mais why not), au niveau individuel :
Regarder la poutre dans son œil avant la paille dans celui du voisin : ça, pour moi, outre l’auto-palpation, je vois ça aussi comme un appel à l’empathie. L’empathie pour tout le monde, sans distinction ? Non. On est loin dans l’article, donc on est entre nous, je peux quand même ouvrir un peu les vannes : les gens des deux boîtes susmentionnées qui ont écrit les slides susmentionnées ? Je les méprise, les conchie, les vomis et je n’ai aucune envie de les excuser. Ma colère n’est toujours pas retombée. J’espère simplement qu’à un moment, elle retombera ne serait-ce qu’un peu, parce qu’il n’y a que comme ça que je pourrai penser la situation. Et la penser, ça reviendra à me poser une simple question : quelle situation il faudrait pour que moi, j’en arrive à écrire ces slides ? Car je suis persuadée que la certitude nous rend aveugles. La certitude qu’on ne ferait jamais ça, celle qu’on aurait évidemment été Résistant·es en 40, nous rend aveugles aux centaines de petits glissements qui amènent des gens exactement comme nous à faire des choix qui nous semblent si étrangers.
Ne pas abandonner l’idée du “changement de l’intérieur” mais en questionner les limites : est-ce qu’un changement de l’intérieur est possible ? Très probablement. Est-ce qu’il peut être radical ? C’est pas sûr. Mais même s’il l’était, toutes les organisations ne le permettent pas, et tous les humains ne peuvent pas se le permettre. Ce que je veux dire, c’est qu’à tenter de porter sur ses épaules le poids d’une transformation plus grande que nous, on peut certes faire quelque chose de profondément utile, mais aussi risquer de s’épuiser, de perdre des points de vie, des plumes, la foi. Bref, choisir ses batailles, ce n’est pas trahir, c’est durer.
Cela dit, si on monte d’un cran :
Trouver un peu de collectif, bordel : à l’intérieur d’une boîte, à l’extérieur d’une boîte. Notre atomisation chacun·e dans notre coin avec nos problèmes individuels, notre opposition les un·es aux les autres n’est pas un accident, c’est un dark pattern : le travail est designé pour, et ce n’est pas nous qui en tirons les bénéfices. Trouver du collectif, c’est arrêter de pointer les autres du doigt déjà (et je sais bien que je suis la première à le faire hein, mais en ce moment, même moi, des trucs comme le boomer bashing je commence à trouver ça extrêmement contreproductif), et puis c’est se parler, s’unir, s’organiser, boycotter, faire chier. Arrêter (et encore une fois, je me parle aussi à moi-même) de regarder les mouvements et les initiatives qui se créent avec un œil extérieur, en cachant notre propre inaction sous une critique de leur naïveté et de leur imperfection. Je ne parle pas forcément d’aller brûler des poubelles et de rejoindre des syndicats si c’est pas votre truc. Soyons créatif·ves, au Népal des gens viennent d’organiser un coup d’État et d’organiser l’élection de la cheffe du gouvernement provisoire sur… Discord.
Et puis surtout, oui, en fait, les vraies solutions sont systémiques, et dès qu’on avance une solution systémique on passe pour quelqu’un de naïf, alors traitez-moi de naïve si vous voulez :
On se parle d’un cadre légal plus contraignant pour les entreprises. Elles croulent déjà sous des tonnes de contraintes légales et administratives ? Bichettes. Le devoir de vigilance, la responsabilité des dirigeant·es, les sanctions financières, c’est super. Il en faut plus.
On se parle d’un cadre légal plus protecteur pour les gens : renforcer les droits des salarié·es, bétonner le droit de réserve, renforcer la protection des lanceurs·es d’alerte.
On se parle de transformer la gouvernance des entreprises pour que la voix des salarié·es soit entendue, à tous les étages, dans les décisions.
On se parle de réduire le temps de travail : oui, je n’arrêterai jamais avec ce truc y’a quoi. Il n’y a pas un article où je ne trouve pas une nouvelle bonne raison de le faire. Celle d’aujourd’hui nous vient de Graeber : si on supprimait les “bullshit jobs”, on pourrait diviser le temps de travail de tout le monde de moitié. Qu’est-ce qu’il reste ? Il reste les tâches intéressantes, celles qui sont connectées à la réalité, celles où l’on est davantage responsable des conséquences de ses actions. Celles qui ont du sens quoi.
On se parle de développer des formes alternatives d’organisation du travail : comme les SCOP où les salarié·es sont les associé·es majoritaires et participent aux décisions ou les boîtes de l’économie sociale et solidaire, qui tentent de s’extraire des logiques capitalistiques.
On se parle de renforcer, OUI RENFORCER la sécurité de l’emploi : parce que pardon, je ne vois pas, mais absolument pas de bénef net pour la société à ce que des gens soient poussés à faire des choses néfastes parce qu’iels ont peur de perdre leur job et de se retrouver dans la merde. Gnagnagna on n’a qu’à mettre un revenu universel alors ? Oui, ok, bonne idée let’s go. Graeber en parle, il compare le revenu universel à un “safe word” dans le BDSM : un moyen pour chacun·e de mettre fin, quand iel le souhaite, à la domination (au travail).
Oui évidemment, y’a aussi faire tomber le capitalisme néolibéral.
CDLT,
Sev