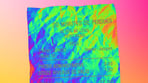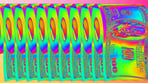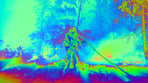Si ça fait pas mal, ça peut pas être bien ?
Pourquoi on continue de lier souffrance et valeur du travail


Coucou les zigotos ! C’est encore moi Bozo le Clown avec dans ma besace en sequins un sujet maxi-golri pour égayer votre quotidien en ces temps de pré-Troisième Guerre Mondiale ! Aujourd’hui on va parler de souffrance au travail !
La semaine dernière j’ai découvert le concept d’HyperNormalisation : l’effort collectif qu’on fait pour maintenir la façade de la normalité alors que tout s’effondre autour de nous. Ça a été formulé par l’anthropologue russe Alexei Yurchak pour décrire la vie en URSS dans les années 70 et 80, où tout le monde SAIT que le système s’écroule mais n’a pas d’alternative à proposer, et maintient donc l’apparence du statu quo en continuant de faire fonctionner la société comme avant. En gros, c’est réussir à se mentir tellement bien collectivement en gardant le nez dans le guidon qu’on parvient presque à y croire.
Moi perso ça m’aide toujours de mettre des mots sur une réalité. Et l’HyperNormalisation, je trouve que ça décrit assez bien ce premier semestre 2025 (et mes efforts vains pour hyperdénormaliser avec des articles sur notre état mental en temps d’apocalypse).
Mais je crois qu’on peut appliquer le concept à plein d’autres sujets. Moi par exemple, y’en a un qui me taraude depuis un bon bout de temps, c’est le sujet de la souffrance au travail. Et plus précisément, du lien inconscient qu’on persiste à faire entre souffrance et valeur du travail. Cette idée que si on a douillé, ça donne plus de valeur à ce qu’on a accompli. Et par extension, que prendre du kif c’est un peu louche, le signe qu’on a choisi la facilité, qu’on n’en fait pas assez, et que ce qu’on produit est nécessairement moins bien.
Et purée, s’il y a bien un sujet HyperNormalisé, c’est bien celui de la souffrance au taf. On entend constamment parler de burn out endémique, de pénibilité, de risques psychosociaux, de 45% de salarié·es en détresse psychologique et… et rien, j’ai envie de vous dire. Il se passe rien. Grande Cause mes couilles. Bien-être mon oeil. On applique un peu de sparadrap type “cours de yoga gratuit” et on laisse les gens dans leur merde, voilà ce qui se passe.
Je ne peux même pas expliquer à quel point ça me tend. Ça me tend que collectivement, on ramasse autant… pour ça. Ça me tend d’avoir vu, au fil d’années de carrière, des gens perdre des cheveux, se trouer l’estomac, péter des câbles, se taper des burn outs, chialer, ne pas dormir, enchaîner les problèmes de santé… à cause du taf. Juste du taf. Un truc qu’on est obligé de faire en échange de pouvoir manger et se loger, et qui, généralement, enrichit d’autres gens. Alors oui, on y passe la majorité de notre temps éveillé. Mais justement. On subit cette immense injustice comme une forme de fatalité.
Le sujet est traité, re-traité, sur-traité, partout, tout le temps, et rien ne bouge. Moi forcément, ça me donne envie de creuser, pour comprendre ce qui permet à la souffrance de rester la norme au travail. Et comme je suis clairement venue ici pour souffrir, je vous préviens d’emblée que je suis tombée dans un vortex : je me suis retrouvée à lire des bouquins parus y’a 50 piges et j’attaque cet article avec zéro idée de comment je vais vous synthétiser tout ça mais une forte envie de vous raconter ce que j’ai capté.
On mixer business, culture, philosophie, psychologie, sociologie, anthropologie et peut-être bien BDSM, et je vais tout faire pour que vous aimiez ça.
Le monde du travail produit structurellement de la souffrance
Autant c’est évident, autant c’est pas mal de commencer par ça.
1/ On se cache pour souffrir
Globalement, souffrir, surtout au travail, c’est une expérience personnelle, intime et surtout taboue. C’est dans les chiottes qu’on pleure, pas dans l’open space. Les gens qui racontent leurs échecs, leurs doutes et leurs galères sur LinkedIn, dans la vie ou dans des interviews le font généralement a posteriori. Et autant, je trouve ça courageux et vraiment super, et il faut continuer à le faire, merci. Autant ça me fout toujours un petit seum, je dois l’avouer. Parce que généralement, ça se passe comme ça : une personne projette du succès et de la win pendant des années, puis finit par révéler qu’en fait, c’était l’enfer en coulisses, mais uniquement quand elle a déjà réussi à rebondir. Résultat, nous tous·tes là, on est uniquement exposé à des récits de gens qui racontent que tout va super bien à un temps T, que ça soit vrai ou non. On ne voit jamais quand les gens sont dans le dur. Et je comprends très bien pourquoi hein, c’est risqué et pas valorisant de dire quand on souffre, et je ne suis en train d’inciter personne à se jeter dans l’arène pour la cause. Mais résultat du résultat, quand on est soi-même dans le dur, on vit ça dans une solitude absolue. On se dit qu’on est anormal·e, que c’est nous qui merdons dans un monde où tout le monde gagne (à la fiiiiiiin deeeeh) (elle fait vraiment “deeeeh”, j’ai réécouté).
Ajoutons à ça une forme de relativisation de la légitimité de la souffrance, notamment dans les métiers intellectuels. Avec des phrases allant de “on n’est pas à la mine” à “on sauve pas des vies” en passant par “c’est pas non plus l’usine”, on cautérise la plaie avec du limoncello : derrière l’alcool de la relativisation se cache le citron de la culpabilisation. On n’a pas le droit de souffrir quand d’autres souffrent plus, et souffrent pour de vrai, physiquement, alors que la souffrance psychique, ben c’est dans la tête. Donc ça compte moins. Sauf que si 45% des employés sont en détresse psychologique, que 30% ont déjà fait un burn out, eh bien côté cadres c’est la bérésina : 54% des cadres selon l’APEC ressentent au moins occasionnellement un stress intense (c’est 63% pour les femmes) et 40% expriment un sentiment de déprime. Et si on en croit l’OMS, les problèmes de santé mentale liés au stress au travail peuvent mener à des taux élevés de dépression et d’anxiété, d’abus de substances, de problèmes sociaux, de risques d’accident, et peuvent conduire à un éloignement du marché du travail, à de l’exclusion et à des comorbidités (de type problèmes cardiovasculaires). Moi ça me semble méga-réel cette histoire.
2/ C’est bien plus large que ça
En 2014, Christophe Dejours (psychiatre, psychanalyste, médecin du travail, professeur au CNAM) a publié un bouquin nommé Souffrance en France - La banalisation de l’injustice sociale dont j’ai envie de vous parler pour deux raisons.
La première, c’est que j’adore le titre, que je suis quasi-sûre que la V1 était “SoufFrance”, et que ça me donne envie de lancer France Souffrance, une plateforme digitale pour matcher les gens qui aiment douiller avec des jobs toxiques.
La seconde, c’est parce que Christophe Dejours, c’est un peu le mec qui surpsychologise les problèmes du travail, et qu’on lui a reproché d’avoir un peu trop mis l’accent sur l’individu dans toute cette histoire. Et pourtant MÊME LUI, il explique que la souffrance est intrinsèque à l’organisation moderne du travail.
En gros, il dit :
On cherche à nous faire croire, ou l’on a tendance à croire spontanément, que la souffrance dans le travail a été très atténuée, voire complètement effacée, par la mécanisation et la robotisation
Avant d’expliquer que :
déjà, y’a encore un PAQUETOS de gens qui réalisent des tâches hautement dangereuses pour leur corps et leur santé, même si on prétend qu’ils n’existent plus : ouvriers du BTP, employés du nucléaire, du nettoyage, des chaînes de montage, des abattoirs, du déménagement, de la confection… On est à 21588 morts et 13,5M de blessés en 20 ans.
ensuite, il y a celleux qui affrontent des risques, cf. la “première ligne” du Covid, et sont exposés à des virus, des radiations, de l’amiante, des horaires inhumains.
enfin, il y a les personnes soumises aux contraintes de l’organisation du travail, et je cite, parce que c’était y’a 11 ans et c’est frais et crousti comme si ça sortait du four : “contraintes de temps, de cadence, de formation, d’information, d’apprentissage, de niveau de connaissances et de diplôme, d’expérience, de rapidité d’acquisition intellectuelle et pratique et d’adaptation à la « culture » ou à l’idéologie de l’entreprise, aux contraintes du marché, aux rapports avec les clients, les particuliers ou le public”
Bref, cette troisième catégorie, si vous lisez CDLT, y’a des chances que ce soit vous.
3/ En fait c’est structurel
Ce qu’il fait ensuite — ça lui prend Dejours — c’est, en effet, de ne pas aller chercher les causes systémiques (mais bon vous les avez : faire plus avec moins, performer dans une économie chancelante avec une compétition féroce, subir un management toxique, des relations de subordination pénibles, rester à jour dans un monde en perpétuelle évolution etc. etc.) mais de brosser un inventaire un peu flippant des formes de cette souffrance normalisée, que je vous vulgarise, c’est-à-dire que je vous les résume avec une familiarité outrancière dans des petits encadrés pour mettre de la couleur sur la douleur :
La crainte de l’incompétence : ça c’est juteux comme un smash burger. C’est la crainte de ne pas être à la hauteur alors même que… c’est impossible. En gros, c’est de savoir que si on respectait à la lettre toutes les préconisations, les process et les consignes, rien n’avancerait, et donc se retrouver à faire en douce des ajustements avec les règles pour réussir à faire son taf correctement. C’est une forme de zèle, mais lose-lose, vu qu’on se retrouve à devoir en assumer les conséquences si ça foire.
La contrainte à mal travailler : là c’est quand on sait ce qu’il faudrait faire mais qu’on en est empêché. Par des process absurdes, par des collègues qui foutent rien, nous sabotent ou retiennent les infos, par une charge de travail irréaliste ou une hiérarchie qui nous pousse à bâcler pour tenir les objos sans vouloir entendre les problèmes (à ce sujet, je vous recommande le docu Netflix de 2022 sur la chute de Boeing c’est exactement ça).
Le manque de reconnaissance : on y reviendra parce que c’est le cœur du réacteur, mais c’est de voir ses efforts rendus vains par l’absence de retour, regard ou validation. Réaliser que, résultat, la douleur n’a même pas de sens.
La défense : celle-là fait exploser le cerveau et éclaire un peu mes questionnements du début. Il explique que face à la souffrance structurelle au travail et parce qu’il faut bien gagner sa vie, on développe des stratégies de protection au niveau individuel comme collectif (blagues cyniques, silences entendus, règles tacites, petits arrangements, loyauté de groupe). On se blinde pour pouvoir continuer sans péter un câble, mais au passage, on se désensibilise, on normalise, on rend tolérable ce qui ne devrait pas l’être. Il appelle ça de la “souffrance éthique” : se retrouver obligé de supporter et perpétuer le mal parce que pas le choice.
Ensuite il fait un point sur l’individualisation du travail, l’appauvrissement de la défense collective, du syndicalisme et tutti quanti :
Quant à ceux qui souffrent de l’intensification du travail, de l’augmentation de la charge de travail et de la pénibilité, ou encore de la dégradation progressive des relations de travail (arbitraire des décisions, méfiance, individualisme, concurrence déloyale entre agents, arrivisme débridé, etc.), ils éprouvent beaucoup de difficultés à réagir collectivement.
Bref, la souffrance au travail n’est pas une anomalie, encore moins une insuffisance individuelle : la seule chose qui est individuelle c’est la façon dont on se retrouve à la vivre.
Ahem vous savez quoi ? J’avais l’intention de faire une première partie super courte. C’est raté. Pour me rattraper, je vais faire une deuxième partie vraiment télégraphique, promis. Juré.
Notre culture lie souffrance et valeur du travail
Les racines culturelles de notre rapport à la souffrance en un thread Twitter :
Dieu (@YHWH) pose un tweet : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. »
Le catholicisme (@JesusRPZ) quote RT : souffrir = se rapprocher de Jésus MAIS rassurez-vous ça ira mieux après.
Max Weber (@Berufmalade) en rajoute une couche en protestant : travail = voie vers le salut et preuve de l’élection divine.
Le capitalisme (@trickle_down) fav et RT.
Les artistes maudits entrent dans le chat : gif de Van Gogh (@earlessboy) qui se coupe l’oreille, story de Baudelaire (@albatrosCtros) “c’est la dep à Paname”, Rimbaud (@drunkboat) fait un tuto sur comment monter une kalash, ça passe de l’opium à la coke, Hendrix, Joplin, Cobain et Winehouse (@27club) glissent en DM avec des emojis tête de mort.
Le capitalisme lâche une photo before/after les stéroïdes : “greed is good”.
Ça buzz, puis ça bad buzz.
Le capitalisme fait un erratum : “hustle culture”, “no pain no gain”, en fait c’est dans la souffrance qu’on peut s’accomplir askip t’as pas compris. Essaye le yoga : y’a 30% de réduc avec le code CASHFLOW.
Voilà. Allez partie 3.
On a besoin de légitimer de la souffrance
OK on a parlé structures, on a parlé culture, on va parler… je sais pas, ça va être le bordel. J’espère que vous vous êtes bien lavé le palais avec la partie précédente parce qu’on arrive au plat de résistance et y’a de la protéine en farandole.
On vient d’établir comme on a pu (par 35° avec un ventilateur en PLS qui me crache de l’air vicié) un truc simple : la souffrance au taf, elle vient en bundle avec le taf. On baigne dedans et TOUT, de l’organisation du travail à la culture, la permet et la favorise. Il y a donc de fortes chances qu’on la ressente un jour ou l’autre. Mais alors qu’elle est véritablement scandaleuse (parce que PARDON, mais c’est vraiment DÉBILE qu’une majorité se nique la vie et la santé en échange de moyens de survie pour enrichir une minorité), on encaisse.
On tient.
Et parce que ça ne sert à rien de gueuler sur le tabou de la souffrance au travail sans faire ma part, même si c’est difficile, voici ma déclaration d’intérêts (comme les ministres dont on apprend qu’ils sont quand même beaucoup à être millionnaires, mais en version émotionnelle). Je me considère comme une personne globalement très heureuse et tout va très bien dans ma vie pro comme perso merci, mais mon patrimoine professionnel affiche à date un capital de : trois burn outs, une quantité innombrable de nuits sans sommeil, une insomnie terminale (c’est quand on se réveille trop tôt) depuis un an et demie, des pics d’anxiété à couper le souffle, des tensions cervicales en béton armé et une déprime du dimanche soir de qualité.
Et en écrivant péniblement cette liste, je me suis dit trois trucs : 1/ ça fait beaucoup 2/ mais en vrai de quoi je me plains, c’est rien 3/ c’est fou comme ça ne m’a jamais semblé une alerte, cette histoire. En faisant cette liste, j’ai l’impression d’être seule, mais en même temps qu’on est nombreux·ses, et en prime que j’ai fait toute ma vie un effort colossal pour considérer tout ça à la fois comme normal — pas de quoi en faire un plat — et comme une erreur de fonctionnement de mon côté.
Et comme beaucoup, au fil de ma vie, j’ai pris la souffrance, non pas comme un signal d’alerte, mais comme un badge, un passage obligé, une preuve de sérieux, de mérite, de maturité.
Pourquoi ?
POURQUOI ?
Je vais tenter d’expliquer ça, parce que merde.
1/ Parce qu’on n’a pas le contrôle
J’avais promis que je parlerais BDSM, c’est maintenant. Quitte à ce que cette newsletter finisse dans votre dossier spams, autant qu’on s’amuse un peu.
On a tendance à balancer le terme “maso” comme une sorte d’ombrelle sur tous les comportements d’endurance de la souffrance. En gros, si on accepte de prendre cher, c’est parce qu’on aime ça, qu’on est le type de personne qui cherche à se faire humilier. Alors que c’est un peu l’inverse, si on creuse. Et OUI, on ne se refait pas, je vais parler latex et menottes mais avec des études académiques.
Une étude de 2020 a exploré le rôle du consentement dans ces pratiques pour essayer de déterminer ce qui les distingue des abus (ouais, bon, la recherche traîne un peu derrière la vie). Et scoop, le consentement y est central et surtout explicite : toute séance commence par une discussion détaillée des limites de chacun, des safewords sont mis en place pour y mettre fin sans avoir à se justifier, et le tout est encadré par des règles claires, une communication continue et une éducation permanente au sein de la communauté.
Des études, notamment cette étude pilote en 2020, commencent à tenter d’analyser ce qui se passe chimiquement dans le corps des dominant·es/soumis·es pendant une séance. Et en gros, côtés soumis·es, on a une augmentation de cortisol (le stress) et d’endocannabinoïdes (effet anti-douleur et euphorisant). Donc un plaisir immédiat lié à la souffrance. Or, cette étude qui propose une théorie expliquant pourquoi on peut lier douleur et plaisir dans ces pratiques, avance un mix de facteurs : contexte, souvenirs, relations, psychologie. Et notamment :
we know that the experience of pain is influenced by […] the extent to which one perceives having control over pain […] and the feeling that one has control over the ending of pain
En bref, le BDSM est un cadre formalisé, consenti, sûr et sécurisé, dans lequel même lorsqu’on nous l’inflige, on possède du contrôle sur la douleur et on peut choisir d’y mettre fin sans se justifier, et sans conséquences. C’est l’opposé exact du monde du travail aujourd’hui.
Ce que j’essaie de dire c’est :
On est mieux traité dans un donjon où une personne avec un fouet nous met en cage et nous ordonne de lécher le sol que dans le monde du travail.
Parce qu’il y a une différence absolument majeure entre se faire bolosser volontairement et se faire bolosser payamment au boulot : le contrôle.
Une étude britannique appelée “Skills and employment survey” mesure depuis 40 ans l’expérience des employé·es britanniques. Et l’une des évolutions les plus radicales au fil des années concerne la mesure de ce qu’ils appellent “task discretion” : la maîtrise qu’ont les gens des tâches à accomplir. En gros, leur pouvoir de décider ce qu’iels doivent faire et comment. En 1992, 62% des travailleur·ses considéraient avoir une “task discretion” élevée. En 2024, c’était tombé à 34%. Une perte évidente de contrôle sur ce qu’on fait au travail. Et ça, c’est juste micro. Au global, de “oh ben tu sais avec cette économie” à “c’est décidé au niveau groupe” en passant par “c’est pas entre mes mains”, on est lancé en mode grand huit dans un immense looping de déresponsabilisation, où les process, la hiérarchie, l’économie et même la géopolitique influent directement sur nos vies sans qu’on puisse y faire grand-chose.
Notre seule marge d’action, alors, revient à trouver du sens. Une légitimité. À construire autour de la souffrance un petit échafaudage explicatif pour continuer à tenir.
2/ On a besoin de donner du sens à la souffrance
Parce qu’il est difficile et souvent hors de notre pouvoir de décider de ne pas souffrir (cf. la vie), mais qu’il est encore plus difficile de souffrir pour rien, en tant qu’humains, notre réflexe face à l’impuissance c’est de légitimer la souffrance en lui donnant du sens.
Vous connaissez le biais de la “justification de l’effort” ? C’est simple : plus on a trimé pour un truc, plus on a tendance à lui apporter de valeur a posteriori. Ça a été formulé par une étude de E. Aronson & J. Mills en 1959, je vous la résume dans l’encadré si vous voulez sauter, mais ça parle encore de fesses donc c’est pas non plus chiant :
Aronson & Mills ont proposé groupe de jeunes femmes d’intégrer un cercle de discussion sur le sexe. Mais pour soi-disant s’assurer qu’elles sont à l’aise, ils leur font passer un petit test, différent selon les groupes.
- test du groupe 1 : lire à voix haute en public des mots olé-olé mais ça va
- test du groupe 2 : lire à voix haute en public des mots maxi-crus, genre sashimi-grade, et des passages bien bien tendax de bails genre Fifty Shades
- test du groupe 3 : pas de test
Ensuite, toutes les jeunes femmes écoutent un enregistrement du groupe qu’elles sont censées rejoindre, annoncé comme un peu salace, mais qui se révèle être d’un ennui abyssal.
Et après on leur demande à toutes ce qu’elles pensent du groupe et si elles ont envie de le rejoindre. Je vous le donne en mille : celles du groupe 1 (olé-olé) et du groupe 3 (rien) ont le même résultat (bif-bof), mais celles qui ont dû bien se foutre la honte dans un process d’initiation bien embarrassant ont considéré que le groupe de discussion valait grave plus la peine. Donc en gros, elles ont dû augmenter leur perception de la valeur du groupe pour résoudre la dissonance entre l’effort perçu et le résultat.
Bon, ça a l’air plutôt anecdotique comme ça, mais cette expérience d’exploration de notre réaction à la dissonance entre effort et effet (sous des formes différentes rassurez-vous) a été reproduite sur des enfants comme des animaux avec à peu près le même résultat. Vous connaissez peut-être ce biais sous le nom de “IKEA effect”, c’est le même bail : on place plus de valeur dans une commode Malm (alors que c’est de la merde) si on s’est fait chier à la monter.
Quand la dissonance cognitive est trop forte entre l’effort fourni (3 mois de charrettes et de nuits sans sommeil) et le résultat produit (une révision à la marge du user journey pour augmenter la conversion), on a besoin d’augmenter la valeur perçue du résultat pour justifier la douille (j’ai beaucoup appris/ça a renforcé l’équipe/c’est stratégique pour l’entreprise/j’ai développé ma résilience/ça me sera utile).
Ajoutons à ça le biais du coût irrécupérable (sunk cost fallacy) : quand on a déjà douillé, on a tendance à préférer continuer de douiller — pour que ça n’ait pas été en vain — plutôt que de s’arrêter en chemin, même si potentiellement on a plus à perdre à poursuivre. C’est le fameux “j’ai déjà attendu le bus 15 minutes, à ce taro je vais continuer à poireauter même si je vis à 20min à pied” dans le monde des transports publics, et “je suis au bout du roul, j’ai le bide en vrac, la tête en ruines et le moral dans les chaussettes mais je vais pas lâcher maintenant alors que je vais peut-être enfin avoir une promotion” dans le monde du travail.
Ce n’est pas du masochisme, c’est une tentative profondément humaine de trouver du sens à ce qui échappe à notre contrôle en donnant de la valeur à notre souffrance. C’est ce qui nous permet d’endurer la difficulé, et malheureusement, au passage, de la laisser continuer.
Maintenant, arrive à la quatrième et dernière partie, et normalement c’est la partie qui légitime votre souffrance d’avoir réussi à arriver jusqu’ici.
Comment on justifie la souffrance
Là je vous annonce, je vais faire un méli-boulga de plein de trucs issus principalement d’une épiphanie personnelle récente (mais je vais vous sourcer ça évidemment) : j’ai réalisé que j’ai beau expliquer à longueur de newsletter que ça vaut pas le coup de douiller autant pour le travail, j’ai absolument toujours associé la souffrance à la valeur du taf. J’ai toujours considéré que si je douillais, j’étais dans la bonne direction, que ce que je faisais avait plus de valeur. Je suis en plein process de décrottage mental, et je brûle de vous partager ce que j’ai percuté récemment sur COMMENT on arrive à justifier la souffrance pour continuer à l’endurer.
1/ Le mérite
J’ai déjà fait son sort à la méritocratie dans un article que je vous résume en une phrase : l’idée du mérite sert à justifier de culpabiliser ceux qui n’y arrivent pas en expliquant que c’est leur faute alors qu’un paquet d’autres facteurs économiques et sociaux conditionnent la réussite.
Mais là ce qui m’intéresse, c’est le lien entre souffrance et mérite. Dans l’article, je parlais du podcast Thune, qui est l’un des meilleurs podcasts français de tous les temps, et je pèse mes mots. En interrogeant des personnes très différentes sur le rapport à l’argent, Laurence Vély et Anna Borrel dessinent probablement ce qui est le tableau le plus complet jamais vu de notre relation à la thune. Et dans le dernier épisode, avec Noémie de Lattre, mais aussi dans toutes les interviews d’héritiers et de personnes nées riches, un fil conducteur émerge : c’était trop facile pour moi, je n’ai pas mérité ce que j’ai.
Si c’est facile, ça n’a pas de valeur. Et par extension : quelle valeur j’ai, moi ?
Il faut que ce soit difficile sinon ça ne compte pas.
Et de l’autre côté du spectre, puisqu’on parlait de biais et de dissonances cognitives, j’en ai une autre, bien épicée, à vous partager, issue de ce paper : les auteurs essaient de comprendre pourquoi même des personnes défavorisées croient au mérite comme explication des inégalités. Ils font tout un test impliquant une loterie où le hasard détermine les résultats. L’une de leurs observations est que les personnes désavantagées d’emblée ont quand même tendance à accepter les inégalités, à les trouver “justes” même quand aucun mérite n’est intervenu, et à se convaincre que les personnes avantagées ont atteint leur position par un plus grand effort.
Tout ça pour dire qu’on a globalement l’impression, qui qu’on soit, de ne jamais avoir souffert assez. Si une réussite était facile, alors c’est qu’on ne l’a pas méritée. Si une réussite nous a été volée, alors c’est qu’on ne l’a pas méritée. On gagne jamais.
2/ La quête de soi
Alors ça, c’est le magistral contre-Uno du capitalisme : transformer la souffrance en une voie d’accomplissement personnel. Là, je pick mon player : Danielle Linhart, sociologue du travail, disciple critique de notre ami Christophe Dejours, dans La Comédie humaine du travail - De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale. Pépite je vous préviens, moi ça m’excite au plus haut point, chacun ses kifs.
En gros, elle part du fordisme et du taylorisme, et démonte à son tour l’idée que le travail moderne serait moins créateur de souffrance que le travail physique sous prétexte que ces souffrances seraient psychiques.
Et là, elle nous sort son +4 : elle explique qu’en gros, le management moderne a dû trouver de nouveaux moyens de gérer la souffrance, et a essayé plein de trucs (le participatif, l’éthique) avant de se lancer dans un nouveau modèle non moins vicieux qui est d’expliquer aux gens que souffrance = accomplissement de soi.
Ça serait trahir de vous résumer plutôt que de vous copier-coller cet enchaînement de coups de poing d’une violence parfaitement maîtrisée. On attaque avec un direct :
il s’agit ni plus ni moins que de convaincre les salariés que les exigences qu’ils ont à subir en termes de travail, d’engagement, de disponibilité et de dépassement de soi, dans des conditions en réalité non négociables, leur permettent de satisfaire des aspirations profondes.
On enchaîne avec un petit crochet du droit ?
Le management en vient à présenter les contraintes de plus en plus fortes, les moments les plus ingrats (comme la fixation des objectifs, les évaluations, les contrôles) qu’il impose comme autant de défis à relever qui permettent aux salariés de découvrir qui ils sont vraiment, de faire émerger en eux des qualités qu’ils ne soupçonnaient pas, d’approcher un idéal du moi. Il fait miroiter des occasions de satisfaction narcissique là où l’on pourrait voir des risques psychosociaux.
Et un petit uppercut pour la route :
“Un deal qui revient à promettre une jouissance personnelle à ceux qui accepteront de s’aligner sur des comportements professionnels décidés par des managers en fonction des règles du marché incontrôlées. Car il n’est pas question que les salariés aient leur mot à dire quant aux modalités de cette épopée qu’on leur inflige.”
Moi ça m’a mise KO.
En gros, le monde du travail est un Mon Chéri (pardon aux amateur·ices) : on enrobe la cerise dégueu de la souffrance et des objectifs irréalisables dans le chocolat de “se challenger”, “sortir de sa zone de confort” et “se dépasser”. On fait de l’exploitation subie une quête de soi voulue. Un truc bien pour nous. Et non seulement c’est malvenu de se plaindre, mais en plus il faudrait dire merci.
3/ Le storytelling
Bon j’en ai déjà parlé au début, mais j’en remets une couche parce que c’est important. Puisque globalement on est plus ou moins amené à douiller à un moment ou à un autre, notre société a trouvé la parade : en faire une opportunité de storytelling. Non seulement réussir à trouver du sens à la douleur, mais en faire un outil de valorisation de soi. “Je suis sous l’eau” devient un badge d’honneur, le burn out une étape initiatique, l’abandon de sa vie perso un sacrifice nécessaire. Douiller devient l’étape préalable à toute forme de transformation, de réalisation, et d’accomplissement.
Qu’on s’entende, c’est malheureusement souvent vrai dans les faits. La souffrance est tellement normalisée qu’il faut généralement qu’on arrive à un niveau inouï de douleur pour finalement prendre conscience de l’absurdité de ce qu’on accepte. Genre qu’on se tape un burn out épique pour réaliser que globalement, ça ne valait pas le coup.
Sauf qu’entre-temps, le mal est fait. Les effets sur la santé, sur la vie, sont là et ils ne s’en iront pas si facilement. Et je pense que justement, ce storytelling normalisant participe à endormir les alertes. On se retrouve à avoir besoin d’atteindre le point de non-retour, de frôler l’extrême pour justifier de mettre fin à la douleur. Si vous avez déjà été cette personne qui dit à une autre visiblement à 180km/h sur l’autoroute vers le craquage qu’il est urgent de prendre un arrêt maladie, vous savez : la réponse est généralement “non non ça va aller”. Ça va pas aller.
Mais c’est exactement comme quand on voit aliment dans un état douteux dans le frigo et qu’on l'y repose pour attendre qu’il soit vraiment périmé et se sentir moins coupable de le jeter : on a besoin que ça aille trop loin pour s’autoriser à dire stop.
4/ Le sacrifice pour les autres
C’est sur ce sujet que j’ai touché le fond du rabbithole dans lequel je me suis jetée. Je suis tombée sur un monument datant de 1972 appelé The Hidden Injuries of Class, de Jonathan Cobb et Richard Sennett et à la fin, mes notes étaient quasiment plus longues que le bouquin.
Parce que ce livre a éclairé un truc que je ressens depuis un moment et sur lequel je n’arrivais pas à mettre le doigt : l’impression que cette souffrance au travail est plus forte, et surtout qu’on a tendance à l’endurer plus longtemps, quand on est issu d’un milieu social inférieur à celui dans lequel on évolue. À force d’observer ça en moi et autour de moi, je commençais à bouillir par manque d’explication. Et j’ai eu beau chercher du côté des analyses sur les transclasses/transfuges de classe et de l’habitus, ça manquait encore de ce grain, de cette âpreté que je ne parvenais pas à formuler.
Et ce bouquin est arrivé. Y’a 53 ans certes. Sennett et Cobb y explorent la douleur psychologique cachée des classes populaires, notamment ouvrières, en “ascension” aux États-Unis, et le malaise intérieur qu’elles ressentent en lien avec leur mobilité sociale. Ils parlent évidemment de tout ce qu’on sait : l’incompréhension des “signaux de classe” invisibles quand on se retrouve dans un autre milieu, le manque de respect, les doutes autour du mérite.
Mais le truc. Le truc qui m’a enfin permis de mettre les mots, le voilà.
Ce qu’ils expliquent et qui traverse tout le bouquin, c’est le besoin fondamental de dignité. Il ne s’agit pas juste de subsister, de réussir, mais de se sentir reconnu·e comme digne, d’avoir accès à une estime égale, dont on a été privé par la naissance. Pour les auteurs, la dignité est aussi vitale que la bouffe. Or, ils montrent comment les ouvriers qui ont réussi une forme d’ascension ne parviennent pourtant pas à ce qu’on leur accorde cette dignité : même après des réussites objectives, même avec de la thune, les signaux de classe invisibles cités plus haut (les codes culturels, le langage, le comportement) font qu’on les ramène toujours à leur origine sociale.
ET DONC, ET DONC, ils explorent comment ces personnes issues des classes populaires mettent en place des stratégies pour protéger leur estime d’elles-mêmes et retrouver leur dignité, bref, des moyens de légitimer leur souffrance pour qu’elle ne soit pas en vain.
Et l’une d’entre elles (J’ARRIVE ENFIN AU SUJET), c’est la justification de la souffrance par le sacrifice au service des autres, et notamment des enfants. En bref : j’ai trimé pour qu’on me reconnaisse la dignité, mais on ne me la reconnaît pas, et je justifie donc mon sacrifice en disant que j’ai fait ça volontairement, pour que mes enfants réussissent mieux que moi. A priori, si vous êtes concerné·es ou vous connaissez des gens issus de milieux populaires ou immigrés, vous voyez de quoi je parle : l’idée que le sacrifice des parents sera justifié et racheté par la réussite des enfants. Je cite :
Their future position will redeem the unsatisfying effort a parent makes now.
He has, however, one claim on them: the fact that he is sacrificing himself, his time, his effort, for them. He has still his power to act as an agent for others, to give his wife and children the material means to move away from him. That stewardship he can indeed control. He is acting as a free man when he thinks of himself as choosing to sacrifice. Having been so repeatedly denied by the social order outside himself, now he will usurp the initiative, he will do the denying, the sacrifice of himself will become a voluntary act.
Le truc, c’est que ça établit un contrat unilatéral, car les enfants y sont soumis sans l’avoir demandé.
The sacrificer does not ask his family whether they want him to sacrifice; the very power of this "one-way" contract lies in the fact that one person has wholly usurped the act of giving, and so prevented the others from asserting countervailing personal rights.
Les enfants se retrouvent avec généralement des parents (généralement un père) absents car travaillant comme des forcené·es, autoritaires car compensant leur impuissance au travail par une surpuissance à la maison, et disant “je fais tout ça pour toi” comme explication non négociable.
La pression est donc immense, et les enfants attaquent leur vie avec une dette : s’ils ne réussissent pas, alors tous les efforts de la génération précédente auront été en vain. Mais en prime, ils attaquent avec une vision héritée et non choisie de la réussite, qui amène à une double trahison, perdante quoi qu’il arrive.
S’ils ne suivent pas la voie espérée par les parents, alors ils trahissent, comme l’explique l’un des gamins en parlant de son père :
he’s getting to hate me because I don't want to be a Iawyer or doctor or someone respectable.
Mais s’ils suivent la voie tracée par les parents, ils se retrouvent à trahir aussi, parce qu’ils deviennent différents :
But this means they will now have power over him, will be able to "pull rank" on him […]. Indeed, if the father's sacrifices do succeed in transforming his children' s lives, he then becomes a burden to them, an embarrassment.
Sauf qu’en prime, les gamins se retrouvent, notamment dans leurs études, eux aussi exposés à leur inadéquation, et aux marqueurs de classe qui les font se sentir inférieurs :
these working-class boys and girls are made to feel inadequate by a "laying-on of culture" practiced in college by their teachers and the more privileged students-a process that causes people to feel inadequate […] by subjecting them to an unfamiliar set of rules in a game where respect is the prize
Et le tableau ne serait pas complet, si pour ces gamins, les jobs auxquels iels accédaient n’arrivaient pas avec un peu de culpabilité en prime, comme l’explique l’un des enfants :
These jobs aren't real work where you make something: it's just pushing papers.
Ou comme les auteurs le résument :
They feel they have had more opportunity open to them than their manual-laboring parents. At the same time, they see the parents' work as intrinsically more interesting and worthwhile, and they suffer, therefore, from a feeling of not having made use of their opportunities.
Permettant… de boucler la boucle de cet article : non seulement la pression à réussir est immense, les obstacles énormes, mais en prime, la souffrance potentielle est délégitimée, parce que les parents ont souffert davantage, et pour de vrai, et que si les enfants galèrent, c’est qu’iels n’ont pas été au niveau de ce sacrifice.
Voilà, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça m’a retournée.
Je crois fermement, profondément, que ce mécanisme est pour BEAUCOUP dans une grande partie de ce que je viens d’expliquer. Qu’il n’y a pas plus corvéable et bolossable qu’une personne transclasse, parce qu’en plus de supporter au quotidien les effets de la souffrance systémique du travail, cette personne doit en plus le faire pour légitimer les efforts des générations d’avant. Que ce contrat moral l’accompagne tout au long de sa vie, et rend encore plus difficile de s’extraire de la souffrance. D’une part parce que cette souffrance a été le seul modèle qu’on lui a inculqué : celui de la soumission, d’endurer sans trop faire de bruit. D’autre part, parce qu’elle porte une responsabilité beaucoup trop grande.
Sauf que.
Sauf que.
Et c’est ça, mon épiphanie récente, mais je laisse les auteurs le dire mieux que moi :
To call the pressure working-class fathers put on their kids "authoritarian" is misleading in that the father doesn't ask the child to take the parents' lives as a model, but as a warning
Working-class fathers like O'Malley and Bertin see the whole point of sacrificing for their children to be that the children will become unlike themselves
Sauf que si les parents se sacrifient, c’est justement pour que la vie de leurs enfants soit différente.
Justement pour que les enfants ne souffrent pas autant qu’elleux.
Et je suis profondément persuadée qu’une grande partie des reconversions qui déferlent en ce moment viennent précisément de cette prise de conscience : que si les darons ont douillé, ce n’est pas pour qu’on douille pareil… au contraire. Qu’en prime, s’ils ont souffert pour leurs enfants, et que leurs enfants se retrouvent à souffrir… pour les actionnaires, il y a là un non-accomplissement du contrat qui est encore pire, parce que là, c’est vraiment pour rien.
Et donc on fait quoi ?
J’écris cette conclusion en direct d’un dimanche soir.
Ça peut sembler ironique en ce qui me concerne, d’avoir passé la quasi-intégralité d’un week-end caniculaire à suer sang et eau pour écrire sur la souffrance au travail. Et en même temps, pas tant que ça, et pour deux raisons. La première, c’est que l’écriture c’est un travail certes, mais en ce qui me concerne — et je mesure ma chance — un travail dépourvu de toute douleur. Qu’on s’entende, je ne dis pas que c’est sans peine, sans défis, sans doutes et sans questionnements. Mais c’est sans douleur. Et je percute progressivement que ce n’est pas parce que c’est sans douleur que c’est sans valeur. La deuxième, c’est que mettre des mots sur les choses, moi ça me fait un bien fou, et j’espère qu’à vous aussi.
A priori, là, si vous êtes encore là, on est entre nous, on se sait.
Je crois que si on ne peut pas, avec nos petits bras, renverser du jour au lendemain la toxicité intrinsèque du monde du travail, il y a un truc que l’on peut faire : décider qu’on mérite mieux.
Parce que bon, je vous le dis comme je me le dis : on a le droit de ne pas souffrir au travail.
Donc voilà, si vous là, qui me lisez, vous avez attaqué votre journée avec la boule au ventre, que vos proches s’inquiètent, et que les signes d’épuisement s’accumulent au point que vous vous êtes mis·e en mode avion pour ne plus les voir, je vous supplie de vous écouter, et de voir ces signes pour ce qu’ils sont : des alertes. Arrêtez-vous. Faites-vous aider. D’abord. Ensuite, vous pourrez réfléchir à comment faire pour changer la situation, ou si besoin, vous en extraire.
Et collectivement, je nous propose de :
rejeter en bloc les récits de mérite à la con de gens qui ont fait “l’école de la vie”.
cesser de nous comparer à des histoires de succès et d’échec qui ne sont que des packagings auto-promotionnels d’une histoire partielle.
déclarer forfait au concours de qui est le plus sous l’eau, qui a le planning le plus chargé et qui a fait le plus de charrettes, et se rappeler de ce que c’est : la gamification de l’exploitation.
s’autoriser à extérioriser la souffrance et à la considérer comme grave (parce qu’elle l’est). Et si comme beaucoup vous avez perdu la notion de ce qui est acceptable ou non, Mouvement T a créé le Souleaumètre (vous pouvez le trouver ici à droite sur leur rapport d’activité), un outil de mesure et d’alerte sur le surmenage.
s’autoriser à aller vers ce qui semble facile ou agréable, en ne considérant pas que ça y retire de la valeur, mais qu’au contraire c’est peut-être le signe que c’est la bonne voie.
cesser de culpabiliser de profiter de ce que notre beau pays nous offre en échange de notre travail, comme l’arrêt maladie sans justification nécessaire auprès de l’employeur, la rupture co, le chômage, la médecine du travail (avec tous ses défauts mais c’est un autre sujet). Et continuer de gueuler pour que des dispositifs comme Mon Soutien Psy (remboursement partiel de jusqu’à 12 séances de psy) ou des structures comme les CMP (accueil psy gratuit) cessent d’être des rustines et obtiennent le niveau d’investissement que la situation exige : massif.
changer d’outils de mesure : comme on a réalisé que le PIB d’un pays n’a aucun sens si les inégalités y sont écrasantes, on peut, au niveau des organisations, définir des KPI complémentaires du succès d’un projet ou d’une boîte : baisse du turnover et monitoring de ses causes, baisse des arrêts maladie, livraison d’un projet sans charrette, taux d’utilisation des congés, amélioration du ratio travail effectué/heures travaillées etc.
retrouver le collectif : le souci avec la souffrance dans le travail moderne, c’est que c’est un problème collectif vécu dans la solitude la plus totale. Retrouver le collectif, ça va jusqu’au syndicalisme et rejoindre des assos comme Mouvement T, mais ça commence bien avant. Ça commence par partager son état, faire attention à celui des autres, se faire aider, s’informer et faire circuler les infos ou se regrouper pour monter au créneau.
La souffrance au travail n’est pas une preuve de défaillance personnelle mais de défaillance du système. À partir de là, endurer n’est pas un fait de gloire. Déjà, parce que personne ne nous accordera jamais une médaille. Ensuite, parce que personne ne nous rendra jamais ce qu’on aura sacrifié pour… juste tenir.
Souffrir n’a pas de valeur intrinsèque.
Bordel à chiottes.
CDLT,
Sev